- C'est
dans ces moments-là qu'on aimerait trouver un billet de cinquante
euros à côté de soi, m'a-t-elle dit.
On
habitait ensemble depuis six mois déjà, et on s'entendait bien. Il
y avait des disputes. Dès fois, c'est moi qui ne disait pas grand
chose, dès fois, elle.
Elle
était vindicative, fière, apeurée, comme ce point de scission
entre deux mers qui se rencontrent, loin dans l'océan.
J'étais
amoureux, j'étais nul en maths, je n'essayais pas d'être fier et
j'essayais d'être fier.
J'avais
presque fini la faculté. Je m'étais courageusement décidé à
faire sept premières années et arrêter. Puis je me suis installé
avec elle, et nous nous promettions, nous nous promettions de courir
le monde. L'avantage de courir le monde avec une nana comme ça,
c'est qu'elle est belle. Je veux dire, quelles grandeurs peut ne pas
manquer à son sein ? Laquelle, dites-le moi, je n'arrêterais
pas de la dévorer.
Elle
est une descente vers le vieux port et une pêche à l'espadon. Alors
je n'ai rien appris que pour elle.
Un jour de haut soleil,
nous prîmes le train et partîmes, dépassant Pancho Villa,
Lausanne, Mexico, Singapour, faisant l'amour dans le train, sur la
couchette du haut, car la couchette du bas, prise par mille chats.
En
dépassant Singapour, nous fîmes la rencontre d'un vieux monsieur,
dans le quartier attenant à la gare. Il nous expliqua être seul
depuis l'âge de ses 20 ans. Tout a commencé lorsqu'il s'en alla de
chez ses parents pour rechercher la vraie vie. Il loua un appartement
dans l'Upper East Side, et le jour d'après, le soleil lui semblait
le même. Pestant que cela n'était pas possible, il se rendormit
mais devant sa fenêtre. Pestant, pestant, il ne dormait pas. Et il
roucoulait quelque fois vers les femmes, quelque fois vers lui-même.
Trompant le temps, il allait dans les mines de charbons pour y
travailler. Mais ce travail ne durera pas toujours. Et ce travail ne
dura pas toujours. Nous l'écoutions attentivement, et le soleil
perdura encore un peu sur la gare, sans que ça ne devienne trop
sentimental.
Puis
il s'est endormi dans l'herbe, et nous sommes allés chercher un
hôtel. Ce n'est pas que nous en avions marre de lui, il était juste
tard, et vers Singapour, seuls les hôtels servent à manger le soir.
Il n'y a rien sinon.
Traversant
les rues qui, d'entrefilades en entrefilades, se retrouvaient
elles-mêmes, nous fûmes forcés d'atterrir, et ce fut devant un
bâtiment dont l'éclairage invitait au sourire. L'hôtel San Diego ;
eh oui, de grosses lettres le proclamait.
A
l'intérieur de l'hôtel San Diego, à l'intérieur, un chaton me
regarde. Ce chaton appartient à une maîtresse, qui a une maîtresse.
C'est la patronne de l'hôtel, Odessa. Elle a soixante ans, et
déploie une chevelure abondante, brune et bouclée partout partout.
San Diego et Odessa ne serait rien l'un sans l'autre. Et Odessa
voisinait avec les voyageuses qui passaient par là, et qui ne
s'ennuyaient pas. Car, oui, en effet, elle pouvait être très vite
énervée, et ça n'allait pas sans déboires. Mais ça les
prenaient, et de leurs témoignages, ça les faisaient voyager.
Alors, oui, elle avait des maîtresses, mais comprenez bien que ça
n'en faisait qu'une.
Je
ne l'ai pas reconnue en ouvrant la porte, mais Odessa était une de
mes camarades de lycée. Jadis, quand elle parlait, elle poussait de
grosses vapeurs. Mais c'est fini maintenant, je la trouve plus
raisonnable. Elle nous prêta et nous conduit vers une chambre de
l'hôtel Odessa. En chemin, nous fîmes la connaissance d'enluminures
particulièrement baroque.
Au
sortir de la nuit, au réveil de la chambre, nous vîmes des dizaines
de gangsters parcourant l'hôtel. Certains buvaient du thé. Des
gangsters buvant du thé ? Mais à chaque fois que nous tendions
l'oreille, ils parlaient meurtre, ils parlaient décapitations, ils
parlaient tendons à l'oreille et couillons de cou. Je ne pris aucune
peur, cela non, je ne suis pas de ce genre là. Je protégeais mon
amie, pour tout dire, en lui bouchant les oreilles. Nous descendîmes
vite fait bien fait entre enluminures baroques et nœud papillons
tachés de sang, jusqu'à la sainte Odessa.
A
la question, la réponse fut qu'elle louait ses salles, ses chambres
et ses allées aux nécessiteux, et une confrérie de gangsters ne
devait pas faire exception. Ces gens avaient un énorme besoin
d'attention, alors pour discuter affaires, ils allaient chez la plus
aimante. Odessa leur fournissait du temps pour parler. En ce moment,
le chef et ses sous-fifres étaient empêtrés dans une affaire
d'assassinat, assassinat fait sans l'autorisation du parrain.
On
avait mis à mort deux frères, sur le sable du désert. Ils avaient
trichés au jeu. Normal, donc. Mais aucune élimination ne peut être
réalisée sans l'accord du parrain, du parrain vous dis-je !
Odessa vint nous faire part de leurs problèmes. Mon amie leva sa
main très haut. Je ne connaissais plus mon amie, vous dis-je !
Et elle eut la permission de parler. Car Odessa nous avait
accueillis, accueillis et nourris, et aimés, peut-être, un tout
petit peu ; mon amie sentait en elle le besoin impérieux de lui
rendre la pareille. Après en avoir discutés, nous décidâmes
d'aller parler au parrain pour elle et pour eux. Les gangsters
étaient apeurés.
Nous
traversâmes un parc, sur un petit chemin le serpentant. Le reste
était gorgé de fleurs, et le soleil tombait à pic à travers les
falaises. Au beau milieu du merveilleux, une question : quelle
stratégie ? Elle veut lui apporter quelques bières, ouvrir la
porte, lui expliquer. Il est prévu qu'il pleure. Arrête, arrête,
même le lecteur trouve que c'est de la drague ! Tu te fâches ?
Je te laisse toute seule. Tu ne te fâches plus ? J'arrive, mon
amie, j'arrive. Pour ma part, je pensais plus à une opération
mêlant politique et militaire : nous le forçons à sortir,
nous allons avec lui sur les chemins. Une fois loin, un choix
cornélien s'offre à lui : soit il accepte nos conditions, qui
sont celles des gangsters transmises par Odessa, soit nous le
frappons à mort. Je ne lésine pas sur mes mots. Tu as déjà
frappé ? Je t'apprendrais, je t'apprendrais tout.
Dring,
driiiiiiing. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis occupé, et non, et
non, et non, revenez plus tard. Nous sommes ici pour un problème. Le
dernier problème, c'est vous. Et là, ce connard sort son flingue,
il me le fout sur la tempe. D'un geste rapide, j'éjecte le flingue
vers le haut. Le parrain repère le flingue et s'apprête à le
rattraper – spectacle de cirque. Je tape le flingue du plat de la
main – engagement de basket, et le parcours de celle-ci se finit
sur le nez du patron, qui craque.
Enfin,
nous entrons. C'est un estuaire empli de femmes mortes. Je frissonne,
le gars a des problèmes. Mon amie ne dit rien en tordant le nez. Je
la reconnais, je vois qu'elle ne voit pas bien. Elle pleure, elle l'a
connue. Au centre de la pièce, un rideau, des traces de pas. D'un
geste de la main, elle m'emmène là-bas. Il y avait toute ma peur,
elle me l'a montrée sans chichis. Elle ne voulait pas me tuer, et
moi je ne pensais à rien en refermant le rideau. Mieux :
j'envoyais le parrain ad
patres
en lui brisant le cou. Il ne pouvait plus bouger après.
Un
mot de résolution : la main-mise du parrain sur ses employés
se termina avec la mort de ce dernier. Je n'en suis pas mécontent,
même si la péripétie est trop volatile en soi pour être discuté.
On peut s'engoncer dans un blabla-blabla métaphysique, on peut s'y
perdre, si les résultats sont là, pas de problème. Nous avions
résolu une crise de la pègre, et aujourd'hui les Thompson
1928
chantent encore nos mérites.
Nous partîmes, de
l'hôtel, de la ville, vers Oulan-Bator.
Il y avait un petit
train, du genre scintillant et résistant, qu'il fallait prendre pour
traverser les montagnes. La neige tombait avec le soir et l'altitude,
et nous étions gelés. Je ne pouvais comprendre le tracé de ce
train, dusse-je mourir en essayant. La carte que j'avais sous les
mains ne correspondait rien aux balancements du voyage. Mon amie
sentit que cela, je ne le contrôlais pas, alors elle me serra contre
ses seins, et tangua de plaisir, comme elle l'a toujours fait.
Même maintenant, je n'en
peux plus de me demander pourquoi nous nous arrêtâmes en pleine
nuit sur un col venteux et fouetté par la neige. J'invente, je
n'invente pas et je n'y crois pas un mot.
J'étais le premier à
ouvrir l’œil. Dans le noir du wagon, je vis mon amie, tombée
endormie, et tous les autres voyageurs, en position fœtale tout
autour d'elle. Afin de me dégourdir les jambes, j'allais jusqu'au
wagon-bar en écluser deux, trois. Comme une araignée, je passais à
travers les wagons. A peine arrivé au wagon-bar, à peine servi par
un barman plus réveillé que mort, je pris ma première motte sur
l'arrière du crâne. Effet boule de neige. Le grognement de dieu. Je
suis croyant. De la neige de la neige de la neige nous fend tous le
crâne. Les wagons sont projetés dans la montagne. Le chaos nous
rapproche mon amie et moi, je la plaque sur mon sternum et l'entraîne
dehors. Une minute après, le train se casse en deux, laissant chaque
partie descendre la montagne vêtue d'hurlements triomphants. C'est
alors que le froid rampe dans nos inconscients pour y éclater.
Elle était belle la
neige. Ah, elle était belle la neige. Elle faisait un bel éclat sur
nos crânes endormis. Nous dormions malheureusement, et sans la
faculté de se projeter à l'extérieur de son corps, à ce moment
précis, nous n'étions plus rien. Le vent se pointa avec le soleil
et nous réveilla. Je réussi à m'extirper de la neige crasse, pour
ensuite en tirer mon amie. Autour de nous, tout était escarpé et
blanc. Le soleil n'était pas si loin que ça. Un moment de plus
là-bas l'aurait inciter à se rapprocher encore et encore, nous ne
pouvions nous le permettre. Nos deux personnes, prenant le relais du
train aujourd'hui disparu sur les rails, descendirent la montagne.
Cheminant, nous nous parlions : la haine de la mayonnaise, la
haine du ketchup, les condiments, voilà, voilà, c'était elle, et
je ne pense qu'à elle. Je la voyais vivre dans tous les lieux,
parler dans tous les arts, et de toutes les langues, c'est la mienne
qu'elle tenait par le bout du nez. Nous passâmes grognements sur
grognements avant d'atteindre le premier village.
Dans ce gris et tendre
village, nous passâmes pour des agressifs des montagnes. Je rudoyais
les habitants alors qu'ils m'offraient, qu'ils pansaient des
blessures que je n'avais pas. Mon amie leur parlait une langue
gutturale, mais elle parlait comme eux ? Nous fûmes conduits
chez le chef du lieu. C'était la seule solution, vu la tournure que
cela prenait. Dans une hutte, à l'orée du village, se trouvait le
quidam qui ne se trouvait pas là. Alors sa maison était emplie de
fleurs ; alors, nous entrâmes et les gens refermèrent la porte
brutalement. Les cailloux commençaient à pleuvoir de toutes
fenêtres. Mon amie, se touchant nerveusement le front, commençait à
pleurer. Deux cailloux me touchèrent consécutivement les tempes, si
bien que ses pleurs devinrent un supplice. J'enrageais, j'enrageais.
Je sorti dehors par une des fenêtres brisées, l'orée du soleil
touchait la terre. Ils étaient en rond, tous en rond autour de la
maison. Je ne pensais pas mourir, mais je savais pertinemment que je
n'avais pas beaucoup de temps pour les convaincre. J'inspirais un bon
coup et levai une soudaine voix :
« Enfants, faut-il
s'apaiser ? Pourquoi déposer les armes ? La paix n'a
jamais été une option, ni pour vous, ni pour nous. Nous devons
conquérir, et pour cela, il nous faut enflammer nos conflits, et
pour cela, il nous faut enflammer nos cœurs. Je vois bien que ce
mouvement est en train de se ternir, que cette flamme s'efface comme
les vingt ans d'un octogénaire qui eût une santé de fer encore et
encore. La vie m'a offert cette santé de fer, je l'ai. Je la
sacrifie pour vous, pour vous. Une condition, alors, combattez
l'ennemi, n'acceptez rien. Mourez pour vous, pour vous, votre santé
de fer, vos enfants. » Je pense :
« C'est somptueux.
Que faire ? Après moi, l'acné. »
Ils m'ont poussés. Je
suis tombé. Et, quatre heures durant, ils m'ont examinés, là,
gisant sur le sol. Je n'ai pas sourcillé, pas moi, je n'ai pas
souri. Ils sont partis, penauds. Mon amie s'est précipité vers moi,
et, d'un même mouvement, nous nous sommes précipités plus
profondément la vallée. Ils faisait noir, noir-disparaître, mais
mon amie nous guidait, elle nous guidait.
Avec la nuit, la montagne
pleurait ses éboulements. Avec la nuit, nous tombions de sommeil
dans un refuge fait de bois et de pierres, trouvé au bord du chemin.
Nous n'avions rien mangé. Oulan-Bator était encore loin ; je
pleurais Oulan-Bator mais mon visage ne le montrais pas. La lueur du
feu fait de feuillages éclairait nos regards. Je l'aime. Elle
s'était couverte de pierres et de feuillages, car elle voulait se
cacher de la vallée dans la vallée, non. Elle se dévêtit, dévêtit
devant moi. Moi non, moi si. Moi oui, et nous avons profité de la
nuit dans la vallée de la vallée.
Je me suis réveillé à
six heures cinq. J'avais mal à l'épaule – ma position
chien-de-fusil toute la nuit. A la jambe, le rocher pointu. Accrocs
de nuit, tendons meurtris, on ne peut rien y faire. J'en ai marre de
ces nuits de merde. Alors je me lève, je suis pépère, je suis
tranquille, désespéré. Soulevant la tête de mon amie pour déposer
un baiser sur ses lèvres pourpres et endormies, je vois un voile
laiteux et transparent tomber sur ses yeux. Ses paupières, elles
tombent mais elles ne tombent pas.
Elle me dit d'une voix
claire et forte : « j'ai mis du rouge à lèvres cette
nuit », folle, elle est folle. Je la prends en la sortant
dehors. Soulevant ce jolie visage, j'imagine que le soleil qui naît
dans la vallée saura réveiller ces paupières endormies. Elle
s'effondre en hurlant dès que le soleil éclate. J'hurle à mon
tour, j'hurle, je n'en peux plus. Je la hisse sur mon dos, très
rapidement, comme un sac à patates, et me met à courir vers le bas.
Le paysage s'éparpille autour de moi. A chaque seconde, je risque
d'exhaler mon dernier souffle. L'onde de son corps frappe sans
ménagement la rivière qui serpente au fond de la vallée ; au
contact de l'eau froide, elle réapparaît. Ouf, c'est déjà ça, si
ce n'est ce problème de paupières. Sa vue s'altère et elle n'aime
pas ça. Descendre vers l'aval, vers l'aval, vers l'aval.
- Un remède, un remède,
je veux trouver un remède. Y en a-t-il dans la grande cité
d'Oulan-Bator ?
- Je ne sais pas si je
tiendrais jusque là, mon amour. Mon état empire d'heure en heure,
je ne vais pas tenir encore longtemps.
- Que faire, alors ?
Je suis désespéré. Pourquoi mentir ? Le blanc de tes yeux
m'inquiète. Si tu meurs, je te suis, sans m'inquiéter de demain.
- Misères.
Au loin, un nuage de
poussière prend la rivière dans son panache, et remonte vers nos
deux héros. Une cohorte de cavaliers apparaît devant leurs yeux
ébaubis. Ce sont des mongols aux visages graves et aux moustaches
serpentantes. La richesse de leurs parures fait savoir qu'il ne
s'agit pas de n'importe qui, et qu'ils ne sont pas ici pour n'importe
quoi. Ils s'arrêtent devant eux, et le plus âgé parle :
- Nous venons chercher la
princesse. Mais qui êtes-vous, vous ?
Un soldat s'exclame :
- Je le reconnais, je le
reconnais ! Il y a cinquante ans, il est venu dans notre cité.
Il se disait voyageur.
Mon amie :
- Alors tu as déjà
voyagé ?
Moi :
- C'était pour te voir.
Le soldat continue :
- Il l'a prise, et
enlevée. Mon grand père l'a vu et l'a conté. Et c'est lui, c'est
lui, c'est bien lui, c'est le voyageur aux traits saillants qui a
enlevé à Oulan-Bator sa princesse.
Mon amie :
- Tu es un crétin,
soldat, avant encore, nous étions ensemble.
Le plus âgé parle :
- Ton infection oculaire
disparaîtra là-bas. Suis-nous. Nous te soignerons en chemin.
Nous nous fîmes quelques
signes, elle accepta.
Les soldats ne
m'autorisaient pas dans le cortège, je la suivais de loin.
Après quelques jours de
traverse, nous arrivâmes à la fière cité que j'avais ravi
plusieurs fois par le passé.
Après le couronnement de
la reine, elle disparut de la chambre royale pour se retrouver dans
la mienne, à l'autre bout du monde.


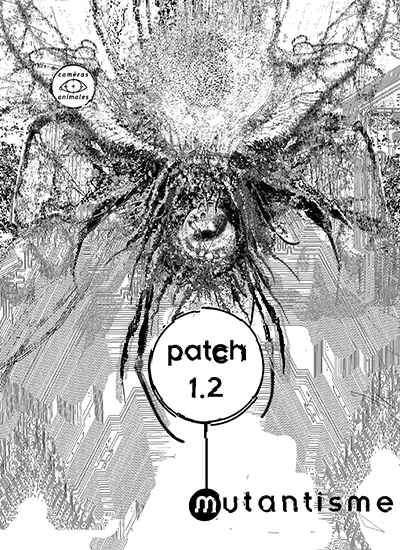


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire