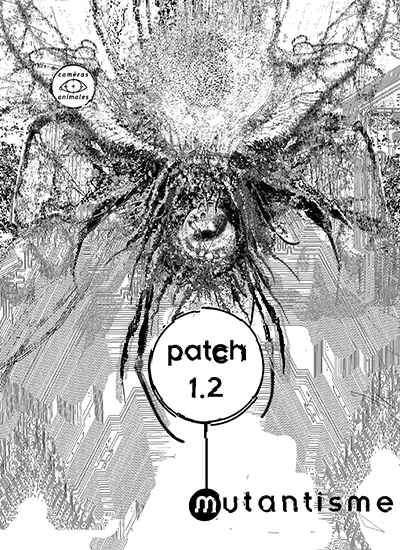jeudi 29 avril 2010
mercredi 28 avril 2010
mardi 27 avril 2010
MARIS EN COLERE
BOB vit dans la rue depuis trois ans, à Paris. Il a quarante ans. Depuis plus de deux ans, il loge dans un squat en dessous du Pont des Arts. Il vit avec trois amis : RICHARDO, MICHEL & ANGELO.
Ce 14 juillet, comme tous les jours de l'année, BOB, RICHARDO, MICHEL & ANGELO vont s'installer vers 13H dans la rue avoisinante et se préparent à mendier pendant toute l'après-midi. Six heures durant, les trois clochards restent assis sur le bord de la rue et tendent des mains implorantes aux passants. Le soleil tombant, ils comptent leurs butins de la journée et arrivent à un total de trente euros.
Ils décident alors d'aller se payer un kebab et une bière dans le grec le plus proche. Ils errent dans les rues, et finissent par entrer dans une sandwicherie afghane. Bob commande pour les trois et ils mangent sur place, malgré les regards déplacés du gérant. BOB, RICHARDO, MICHEL & ANGELO ne font pas attention au cinq hommes qui rentrent un peu après eux. Ces derniers parlent bruyamment et avec un accent russe prononcé. Ils s'installent à côté des clochards et les apostrophent, en rigolant, dans la langue de Tolstoï. Nos trois amis font mine de ne pas entendre au premier abord, mais après cinq bonnes minutes, un des russes assis à la table d'à côté semble pris d'un accès de rage et baragouinent à ses acolytes quelques ordres. Tous se lèvent d'un seul coup, et se précipitent sur BOB, RICHARDO, MICHEL & ANGELO pour les marteler de coup de poings, et de pieds. Ils laissent les clochards la gueule ensanglantée et s'en vont en courant.
ALBERT, 14 ans, cligne des yeux lorsque sa mère, JEANNE, ouvre les rideaux. Sa chambre est remplie de jouets, et des bds trainent sur le sol. Elle lui ordonne de ranger tout ce qu'il y a par terre avant même de venir petit-déjeuner. Albert, résigné, s'exécute, la démarche alourdie par le sommeil qu'il vient à peine de quitter. Ensuite, il se lave et va dans la cuisine. Sa mère, en lui préparant son petit-déjeuner, marmonne. Elle doit aller voir un avocat aujourd'hui pour cette satanée procédure de divorce qui dure depuis trop longtemps. Albert ne peut s'empêcher d'entendre.
Elle l'accompagne ensuite à l'école en voiture, le pose rapidement devant le hall d'entrée, et lui dit « au revoir » du bout des doigts tandis que sa voiture démarre en trombe. Albert marche rapidement pour entrer. Tout le monde est déjà en cours. Il trouve sa salle, toque et entre en s'excusant auprès du professeur de son retard. Il va s'asseoir à l'arrière de la salle. Tandis qu'il installe ses affaires, un de ses camarades se retourne, une grande gueule, plutôt frimeur, et lui demande ou est passé son père. Après quelques échanges assez houleux entre les deux élèves, le professeur leur demande de se taire. Albert a juste le temps d'esquisser un regard menaçant envers son agresseur.
Dans un hall d'immeuble d'entreprise, Jeanne court vers l'ascenseur pour y entrer avant qu'il ne se referme. Elle réussit à y entrer et appuie sur le bouton du vingt septième étage. Arrivée à l'étage, elle court dans le couloir molletonné jusqu'à une porte à droite qu'elle ouvre violemment. Dans le bureau se trouve un homme d'une soixantaine d'années auquel Jeanne demande d'accélérer la procédure de divorce. Elle argumente en disant que cela dure depuis trop longtemps. Elle lui demande d'agir avec rapidité, pour que le divorce soit achevé avant que son mariage avec Miklaev. Celui-ci a lieu dans trois mois, et toute sa famille vient des Balkans pour assister à l'événement.. Le vieil avocat hoche gravement la tête.
Bob, la gueule encore ensanglantée - bien qu'on puisse apercevoir de part et d'autre de son visage, des traces d'eau – est devant le hall d'entrée de l'école d'Albert. Il oscille de droite à gauche, et se tient la tête comme si celle-ci tournait encore. Des parents sont autour de lui, tous attendent la fin des cours. Une sonnerie stridente l'annonce. Les élèves sortent par grappes.
Bob voit Albert avec ses amis, se passant de mains en mains des figurines des tortues ninjas. Bob marche vers lui rapidement. Soudain Albert le voit et esquisse une grimace de dégoût. Bob essaye de le prendre dans ses bras, mais Albert le repousse brusquement et tout ses amis s'esclaffent. Albert regarde son père d'un air dur et lui dit en riant jaune qu'il ne sera plus jamais capable de lui faire vivre des histoires de super-héros et qu'il ferait mieux de s'en aller. Puis Albert défie tous ses camarade pour un sprint : le premier qui arrive jusqu'au terrain de foot. Bob les regarde partir au loin, tandis que lui reste planté devant la sortie d'école qui peu à peu se vide de ses occupants.
La nuit tombe. Jeanne est adossé à sa voiture, à côté du terrain de foot. Elle est au téléphone, et sa voix prend de manière variable des accents implorants et coléreux. Elle parle à Miklaev, lui disant que s'il insiste, elle pourrait être chez lui, ce soir, à 23h. Albert arrive au loin. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, sa mère s'aperçoit qu'il est couvert de boue, de la tête aux pieds, si bien qu'on ne distingue même plus son visage. Elle l'engueule violemment et lui met une claque. La réaction du garçon est d'aller se réfugier dans sa voiture. Soudainement, un orage éclate. Jeanne rentre précipitamment dans la voiture, et, sans dire un mot à son fils, démarre en trombe. Albert regarde dans la vitre arrière, d'un air pensif, et voit une silhouette détrempée, à côté du terrain de foot. Il esquisse alors une moue d'indifférence et se cloître dans le silence jusqu'à leur arrivée.
Bob, Richardo, Michel & Angelo sont assis en rond dans ce qui semble être le squat qu'ils occupent. Des candélabres rouillés leur permettent un éclairage de fortune, et trois bouteilles de rouge poisseux font office de chauffage. Bob prend la parole : il dit à ses amis, avec de grands gestes théâtrales, que les gens de leur espèce on souvent été sous-estimés, qu'il importe maintenant de montrer à la société l'étendue de leur talent. La lutte ne sera pas vaine, argumente-il, nous gagnerons de la fierté qu'on nous a souvent refusés. Richardo, Michel & Angelo agitent convulsivement leurs bouches édentées, laissant échapper un rire caverneux. Comment va t'on faire? Demandent-ils en choeur. Bob se lance dans un discours pompeux et grand-guignolesque, leur disant que la plèbe de la société résidait maintenant en ces petits voyous minables qui pullulaient dans la capitale, ces immigrés sans foi ni loi devraient être punis comme ils le méritent. Michel & Angelo s'exclamèrent que les russes qu'ils leur avaient infligés une raclée mériteraient une leçon. Tous poussent des cris bestiaux de joie et d'ivresse. Ils décident alors, comme première action, de retrouver les voyous russes de l'autre fois. Pour cela, dès le lendemain,et tôt qui plus est, ils iraient se renseigner auprès du gérant du Kebab dans lequel l'altercation avait eu lieu.
Albert est dans sa chambre, seul, et joue à la console sur son lit. Sa mère, en soutien-gorge, passe la tête dans l'entrebaillure de sa porte et lui dit qu'elle va sortir ce soi, qu'elle ne sera pas là cette nuit, et qu'elle viendra le cherche demain matin sur le trottoir devant chez eux pour le conduire à l'école. Pour dîner, Albert n'a qu'à se faire réchauffer les restes du frigo. Il hoche la tête en signe d'acquiescement, sans quitter les yeux de son écran. Elle referme alors la porte de sa chambre, puis quelques minutes plus tard, Albert entend la porte de l'appartement se claquer, des talons descendant les escaliers en grande trombe, et une voiture démarrant bruyamment.
La voiture de Jeanne passe devant un kebab, et se gare au pied d'un immeuble. Elle descend rapidement, vêtue d'une robe affriolante, et va sonner à l'interphone. Une voix russe, rugueuse et roide sort de l'appareil, demandant l'identité de la personne. Jeanne titille langoureusement le bouton de l'interphone et lui répond en des termes très affectueux. La porte de l'immeuble s'ouvre, elle rentre.
Le soleil se lève sur le Pont Neuf. Bob, Richardo, Michel & Angelo pointent le nez dehors timidement. Sans rien dans le ventre, on les voit partir faire le tour des commerçants dans le but de réclamer quelques denrées.
Vers 14H, les quatre compère décident d'aller au kebab. Dès leur arrivée, ils commandent à manger et demandent au gérant des renseignements sur les russes qui étaient venus ici dernièrement. Le vendeur, un arabe affable, leur dit qu'ils viennent à chaque fois d'un immeuble se situant à côté. Il leur dit aussi que des gens comme eux ne devraient pas s'attaquer à ces russes, car ils font probablement partie d'une sorte de mafia. Bob semble ragaillardi par les paroles de l'arabe affable. Lui et ses amis mangent rapidement puis sortent parcourir le quartier. Ils déambulent avec une assurance surprenante dans les rues. Bob voit une femme sortir d'un immeuble au loin. Il croit la reconnaître : c'est son ex-femme, Jeanne. Elle est accompagnée d'un homme d'allure sec, pourvu d'une longue barbe. Il est habillé d'un costume noir, et fume un cigare. Ils se dirigent vers une limousine noire se trouvant un peu plus bas dans la rue. Bob court vers eux, laissant ses camarades en plan.
Le voyant arriver au loin, Jeanne le reconnaît à son tour et le dit à Miklaev, qui se trouve être l'homme qui l'accompagne. Ce dernier sourit. Lorsque Bob s'arrête à côté d'eux, Jeanne lui demande ce qu'il fait là. Bob lui dit qu'il veut revoir son enfant. Elle réplique qu'il ne le considère plus comme son père désormais. A ce moment-là, Miklaev part d'un grand éclat de rire. Bob lève un poing menaçant vers lui. Tout de suite, Miklaev lui allonge une droite qui cloue Bob à terre. Jeanne et Miklaev, alors, en profite pour rentrer rapidement dans la limousine, et la voiture démarre en trombe.
Albert avale une dernière gorgée de son bol de chocolat au lait. Il finit sa tartine, range le petit-déjeuner rapidement, puis traverse l'appartement vide pour aller prendre son cartable. Il descend les marches jusqu'à la rue en traînant les pieds. Arrivé dehors, il s'assoit sur le rebord du trottoir et attend. On entend le vrombissement d'une voiture au loin. Peu à peu, le bruit se rapproche et apparaît à l'autre bout de la rue une limousine noire lancée à pleine vitesse. La voiture s'arrête, la portière s'ouvre et Jeanne apparaît, dans sa robe de la veille. Elle lui dit de monter et il s'exécute.
Le parvis devant l'école est encore noir de monde lorsque la limousine s'arrête sur le trottoir d'en face. Tout les enfants ont le regard pointé sur la portière qui s'ouvre, laissant apparaître Albert, très fier de son effet. Tout de suite, quelques gamins accourent, et commencent à discuter avec lui, en lui passant des figurines de Batman. Miklaev et Jeanne ont juste le temps de lui faire un signe de la main avant qu'Albert ne disparaisse à l'intérieur de la cour de récréation.
Bob, Richardo, Michel & Angelo sont dans le renfoncement d'une ruelle. Des bières à la main et des cadavres de bouteilles à leur pieds, leurs sujets de discussions varient de la façon dont il faut s'y prendre pour reconquérir le cœur de Jeanne et l'amour filial d'Albert, à la bonne leçon qu'il faut donner à ces gangsters russes. Le débat est endiablé, et rythmé par rots foireux et pets odorants.
A l'acmé alcoolique du débat, les quatre clochards se disent alors que la meilleure façon pour Bob de redorer son blason de père est de mater ces truands russes devant les yeux ébahis de son fils. Ils décident alors de retrouver ces truands et de les emmener jusqu'à la porte de l'école d'Albert, et de leur régler leur compte là-bas.
Miklaev, Jeanne et Albert dînent tous ensemble dans l'appartement. La nuit tombe. Miklaev et Jeanne disent à Albert qu'ils ont vus Bob, son père, aujourd'hui dans un état de déchéance assez absolu. Albert ne dit rien et se contente de les écouter. Ils continuent en disant à Albert d'être prudent quand il marchera dans la rue désormais. Pour peu que l'avocat fasse bien son travail, plus que quelques jours et le divorce est prononcé. Alors Bob aurait interdiction d'approcher Jeanne et son enfant. D'ici-là, lui disent-ils, il faut être très prudent. Albert acquiesce, sans rien dire.
Imbibés jusqu'à l'os ce soir-là, les quatre clochards décident d'aller voler la limousine du nouveau petit copain de Jeanne. Ils se faufilent lourdement jusqu'à l'immeuble ou est garé la limousine. Mais, à peine arrivés, ils font la rencontre de la bande de russes qui leur avaient fait la tête au carré. Ceux-ci les reconnaissent et commence à les courser. La bande de clochards s'enfuient et court à tire d'ailes. La course-poursuite passe devant l'immeuble ou est situé l'appartement de Jeanne. Miklaev fume une cigarette sur le balcon. Il les voit, baragouine quelques mots en russe d'une voix forte et autoritaire. La bande de gangsters s'arrêtent, surprise. Bob et ses amis s'arrêtent aussi et les regards de Miklaev et de Bob se croisent l'espace d'un instant, puis ils se sauvent en courant.
Miklaev jette sa cigarette dans le vide et quitte le balcon précipitamment. Il va voir Jeanne qui vient juste de finir de coucher son fils. Il la prend à part pour lui dire que, jusqu'à que le divorce soit prononcé, il ferait mieux de faire escorter Albert, par ses hommes. Jeanne opina de la tête sans piper mot.
Bob et ses amis viennent de rentrer dans leur squat. Ils ferment la porte derrière eux. Bob se met tout d'un coup en colère, insulte ses amis en disant qu'ils auraient du s'en douter. Le nouveau copain de Jeanne ne pouvait qu'être mêlé à cette histoire de tabassage, c'était évident. Leurs yeux étaient fermés depuis le début, mais maintenant ils voyaient la vérité. Et ça n'allait pas se passer comme ça. Tout d'abord, ils allaient retourner voler la limousine dans quelques heures, puis le lendemain, ils conduiraient la limousine jusqu'à la sortie de l'école pour pouvoir voir Albert, son fils chéri, avant qu'il ne rentre en classe le lendemain matin. Un cri sauvage de joie fit s'ébranler les fondements du squat.
La lune est à son zénith. Quatre ombres tanguent en plein milieu de la rue. Leurs ombres se reflètent sur le goudron. Bob & ses amis arrivent alors devant la limousine noire et, armés d'un pied de biche et d'un passe-partout, ils entreprennent d'ouvrir la voiture. Après ¼ d'heure, ils y arrivent. Cinq minutes après, la limousine démarre et Bob va la garer en dessous du Pont Neuf pour la nuit.
Le lendemain matin, Albert est accoudé à la table de la cuisine, il boit son chocolat au lait et mange sa tartine d'un air endormi. Dans l'embrasure de la porte apparaît Miklaev et Jeanne. Jeanne est en robe de chambre sexy et chauffe amoureusement Miklaev, qui allume une cigarette. Albert semble indifférent à ce manège. Miklaev s'approche de lui, s'agenouille à sa hauteur, le regarde dans les yeux et lui dit qu'aujourd'hui, il va le conduire à l'école en limousine, comme une vraie star. Albert acquiesce de la tête, alors Miklaev se relève et va jeter son mégot par la fenêtre. Il s'aperçoit alors que sa limousine n'est plus là. S'ensuit une grande crise de colère. Puis il se calme, décroche son téléphone et baragouine quelques mots en russe de manière hargneuse. Il s'agenouille encore devant Albert et lui dit que ses hommes vont venir le chercher et vont le conduire à l'école, et cela sera aussi impressionnant qu'une limousine. ¼ heure après, une bande de gorilles russes vient sur le trottoir d'en face. Ils grognent, baragouinent et fument des cigarettes. Miklaev et Jeanne disent à Albert de prendre son cartable et de descendre les rejoindre. Miklaev leur a donné des instructions pour qu'ils l'amène à l'école. Le petit garçon, intimidé, leur dit en revoir et va rejoindre ses pseudo-gardes du corps. Ceux-ci l'accueillent avec des manifestations bestiales de joies et la bande se met en route. La pluie commence à tomber.
La limousine est garée devant l'école. Il pleut à torrent maintenant. Bob et ses compères sont dedans et pouffent de rire comme des gamins. Une bouteille de rouge passe de main en main. Ils jettent de temps à autre des regards à l'extérieur de la voiture. Ils voient, en train de s'approcher de l'école, la bande de russes qui les avaient tabassés. Au milieu d'eux se trouve Albert avec son cartable. Bob arrache la bouteille de la main d'un de ses camarades et en boit une bonne moitié au goulot. Puis il va se placer doucement derrière le volant. Les russes, de leur côté, ont achevés de poser Albert à l'école et lui dise « au revoir » d'un signe de la main tandis que celui-ci s'engouffre dans l'école.
Bob démarre rapidement et précipite la voiture vers les russes. La première accélération en fauche quelques uns. La panique prend les autres. Albert, intrigué par le bruit derrière lui, se retourne et aperçoit la scène : une limousine noire passe et repasse sur la bande de russes en les écrasant uns à uns. Quelques uns essaye d'ouvrir les portières, mais ils se font rejeter violemment par des coups de pieds venant de l'intérieur de la voiture. Albert est muet de terreur devant le massacre qui est en train de se passer.
Bientôt plus un russe ne bouge. Des passants commencent à affluer et on entend des cris venant de l'intérieur de l'école. Tous les élèves de l'école ont la tête collé aux fenêtres. Tandis que la limousine effectue une marche arrière pour partir, Albert sort de l'école. La voiture vrombit et part au loin. Albert, détrempé, est sur la route. Il regarde la limousine partir.
Richardo, Michel & Angelo sont assis sur les sièges arrières de la limousine et le regarde par la vitre arrière. Au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, ils n'aperçoivent plus qu'une silhouette détrempée, sous un rideau de pluie, agitant la main.
>
scenario
lundi 26 avril 2010
Sur un bout de feuille retrouvé après un déménagement
Mon quartier, c'est une cervelle de rat. Sa complexité, ses connexions, ses possibilités, le réseau de ses possibilités. La combinaison de ses façades et de ses arrière-cours, de ses constantes et hasards, de ses grappes de cellules, d'habitations, d'appartements, de commerces, de maisons. Cet ensemble complexe, mais limité géographiquement, possède la complexité, le niveau de complexité, d'une cervelle de rat, ou de singe peut-être. Les gens et les objets qui l'habitent et la traversent en sont en quelque sorte les super-neurones, dont les trajectoires, évitements, rencontres et collisions forment du sens, un système, des pensées incarnées dans le monde même, un inconscient collectif. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas mon quartier, mais sa relation avec 1, 2, 10, 50, 1000, 10000 autres quartiers similaires qui l'entourent, avoisinants, avec lesquels il entretient, développe, des rapports, des interactions.
1 cervelle rat
2 cervelle super-rat
3 cervelle chien
4 cervelle singe
5 cervelle humain
Mon grenier est marécageux. Les choses y circulent, ralenties par la macération.
Un seul quartier est encore possible à comprendre, même si c'est difficile. Ses logiques de circulations, de caches, peuvent être peu à peu étudiées, voire comprises. Ce sont des entités complexes, mais à la portée de notre compréhension, si nous y portons beaucoup d'attention, de temps et d'effort. Mais un quart + un quart + un quart. La femme un milieu il risque de _____ toute la journée. L'agglomérat des cellules, des histoires issus des différents quarts forme un tout difficile à ___ [englober mentalement], une complexité dépassant notre entendement et augurant le _____________ de la sieste.
Ce bout de quartier dans le 17e est une cervelle de rat. Mon quartier à Montreuil est une cervelle de rat. Mais l'accumulation, l'agglutination et la mise en relation de ces quartiers n'est plus une cervelle rat, mais une cervelle complexe, inconnue, surhumaine, composée de centaines de petites cervelles mises en réseau, accroissant les probabilités de pensées et d'évènements. L'ensemble est un cerveau géant et modulable. Une machine impensable, incalculable, une maxhine, un cerveau-ville, un cerveau-monde très supérieur à la compréhension d'humainimaux dans notre genre. Cette complexité nous dépasse, nous titille, nous englobe, nous y rôdons, attrapant çà et là quelques codes, quelques algorithmes particuliers à un coin de rue. Les oiseaux dans le ciel constituent un bruit de fond, un plancher sur lequel, tels des trajets de neurones, s'entremêlent des millions de trajectoires de dealers, de petites vieilles, de représentants, de familles, de SDF, de voyageurs, de politiques, d'ouvriers, d'employés, de curés, de flics, d'artistes, de sportifs, d'enfants, d'étudiants, de cols blancs, de professeurs, de médecins, de camés, d'imams, de croque-morts, de putes, de musiciens, de facteurs, de cuisiniers, etc. Chacun d'entre nous est un trajet neuronal fendant le cerveau du monde d'une manière particulière. Cela dure une vie pour nous, cela dure 1/10 de seconde dans le cerveau-monde.
Il y a aussi plein de petites tombes dans les cellules, des cellules-tombes. Les corps sont mus et tombent, entre temps traversés par des pensées, des émotions, des sensations, des paroles, et produisant des modifications. Un corps est activé, il se développe, sent et produit, parfois communique, puis s'arrête.
La vie c'est le sang qui tourne, la narine qui frémit, le baiser que l'on porte.
La mort d'un corps produit un creux particulier, un différentiel de vide, pour les autres corps l'ayant croisé, et n'étant pas encore tombés. La mort d'un corps modifie le cerveau-monde.
Le corps est un fleuve prenant de multiples formes et renouvellements. La musique intérieure d'une conscience, la mémoire, sont des excroissances abstraites accidentelles non communicables et perdues à jamais à l'arrêt du corps.
1 cervelle rat
2 cervelle super-rat
3 cervelle chien
4 cervelle singe
5 cervelle humain
Mon grenier est marécageux. Les choses y circulent, ralenties par la macération.
Un seul quartier est encore possible à comprendre, même si c'est difficile. Ses logiques de circulations, de caches, peuvent être peu à peu étudiées, voire comprises. Ce sont des entités complexes, mais à la portée de notre compréhension, si nous y portons beaucoup d'attention, de temps et d'effort. Mais un quart + un quart + un quart. La femme un milieu il risque de _____ toute la journée. L'agglomérat des cellules, des histoires issus des différents quarts forme un tout difficile à ___ [englober mentalement], une complexité dépassant notre entendement et augurant le _____________ de la sieste.
***
Ce bout de quartier dans le 17e est une cervelle de rat. Mon quartier à Montreuil est une cervelle de rat. Mais l'accumulation, l'agglutination et la mise en relation de ces quartiers n'est plus une cervelle rat, mais une cervelle complexe, inconnue, surhumaine, composée de centaines de petites cervelles mises en réseau, accroissant les probabilités de pensées et d'évènements. L'ensemble est un cerveau géant et modulable. Une machine impensable, incalculable, une maxhine, un cerveau-ville, un cerveau-monde très supérieur à la compréhension d'humainimaux dans notre genre. Cette complexité nous dépasse, nous titille, nous englobe, nous y rôdons, attrapant çà et là quelques codes, quelques algorithmes particuliers à un coin de rue. Les oiseaux dans le ciel constituent un bruit de fond, un plancher sur lequel, tels des trajets de neurones, s'entremêlent des millions de trajectoires de dealers, de petites vieilles, de représentants, de familles, de SDF, de voyageurs, de politiques, d'ouvriers, d'employés, de curés, de flics, d'artistes, de sportifs, d'enfants, d'étudiants, de cols blancs, de professeurs, de médecins, de camés, d'imams, de croque-morts, de putes, de musiciens, de facteurs, de cuisiniers, etc. Chacun d'entre nous est un trajet neuronal fendant le cerveau du monde d'une manière particulière. Cela dure une vie pour nous, cela dure 1/10 de seconde dans le cerveau-monde.
Il y a aussi plein de petites tombes dans les cellules, des cellules-tombes. Les corps sont mus et tombent, entre temps traversés par des pensées, des émotions, des sensations, des paroles, et produisant des modifications. Un corps est activé, il se développe, sent et produit, parfois communique, puis s'arrête.
La vie c'est le sang qui tourne, la narine qui frémit, le baiser que l'on porte.
La mort d'un corps produit un creux particulier, un différentiel de vide, pour les autres corps l'ayant croisé, et n'étant pas encore tombés. La mort d'un corps modifie le cerveau-monde.
Le corps est un fleuve prenant de multiples formes et renouvellements. La musique intérieure d'une conscience, la mémoire, sont des excroissances abstraites accidentelles non communicables et perdues à jamais à l'arrêt du corps.
samedi 24 avril 2010
mercredi 21 avril 2010
THE KING AND THE SEVEN SONS
Elle ne peut plus
Elle est
je lui manque
Mon oeil droit s'obscurcit, car l'opération s'est mal passée.
Je l'ai dit
je l'ai pensé
Et je l'ai fait
Ca ne va pas de travers. Pourquoi ça irait de travers? Tout est encore beau, dehors.Ah, je n'y avais pas pensé : tout, tout peut encore s'obscurcir.
Elle je ne
m'y ferais pas à ça
à moi
Quand on pense à une vie : on imagine faire plus que nécessaire, à chaque fois. Mais on frôle le machinique. Tout ce qu'il y a, c'est que tu ferais mieux de courir.
Elle, elle est belle.
Ou êtes-vous?
>
POESIE
mardi 20 avril 2010
à mettre en parallèle avec (pour mémoire) voix synthétiques et voix humaines de réplicants :
https://r3plyc4n.bandcamp.com/track/mathias-richard-r-plicants-captation-soir-e-pan-octobre-2007
lundi 19 avril 2010
dimanche 18 avril 2010
samedi 17 avril 2010
jeudi 15 avril 2010
space robots
A humanoid robot will visit space for the first time in September aboard the Space Shuttle Discovery, NASA announced Wednesday.
The Robonaut 2, which was co-developed by NASA with General Motors, will serve as an assistant to the humans on board the International Space Station, using the same tools developed for astronauts.
lundi 12 avril 2010
"Partons avant qu'ils nous fassent un coup en vache !"
y a pas à dire, les 80s sont le terreau du mutantisme.
Pixellisation cosmique
PIXELS by PATRICK JEAN.
envoyé par onemoreprod. - Films courts et animations.
[merci à mobilis inmobili]
dimanche 11 avril 2010
- Bon Dieu, tous ces nerfs qui s'agitent. Je crois que je ne deviens plus moi-même, dit Jaub.
Mais la maladie l'avait pris un dimanche matin. Pourtant le soleil était beau dehors, mais la maladie l'avait pris.
Il essaya de se lever, dans sa chambre. Sa chambre au premier étage donnait sur le dehors. Sur le dehors, oui, et il ne pouvait se résoudre à ouvrir la fenêtre de peur qu'un gros bourdon entre et bourdonne. Et pourtant, pourtant sa fenêtre donnait juste devant, juste devant celle des voisins. La voisins avaient un espèce de vasistas ou tout pouvait se voir. Ils ne faisaient tellement rien que ça en devenait dégoûtant.
Jaub se torturait sur sa chaise et se refusait à bouger. Cela le lui grattait à l'extérieur de la tête, à l'arrière et il grattait, il grattait tant qu'il pouvait. Et, à des moments très incongrus, une petite partie de lui sortait de lui et le regardait - lui.
- Qu'as-tu à dire ? dit Jaub.
Le fait est que sortir de son corps et se regarder, se regarder ne nous rend pas plus loquace. Au contraire, c'est dangereux. Lutter contre un point, lutter contre un point.
Pas à pas, vers le flux grésillant, Jaub prit ses cliques et ses claques et marcha. Au moment d'entrer, dans le flux grésillant, il hésita. Le flux grésillant est là ou il ne faut pas aller - il faut rebrousser chemin. Mais pourtant il est inévitable qu'à cette sortie allait correspondre une autre entrée.
Jaub ne se rendra pas.
samedi 10 avril 2010
samedi 3 avril 2010
champignon atomique (mais pas celui auquel on pense)
Radiotrophic fungi are a recent discovery, first seen as black molds growing inside and around the Chernobyl Nuclear Power Plant. These fungi appear to use the pigment melanin to convert gamma radiation into chemical energy for growth.
(via Fresh Photons)
vendredi 2 avril 2010
Création de sections mutantistes locales
Pour créer votre section mutantiste locale,
écrire à
contact@camerasanimales.com
To create your own local mutantist section
write to
contact@camerasanimales.com
more fun to come...
écrire à
contact@camerasanimales.com
To create your own local mutantist section
write to
contact@camerasanimales.com
more fun to come...
jeudi 1 avril 2010
LA DERNIERE SEDUCTION
Monsieur Henri Edwards, 40 ans, est un agriculteur du Val-de-Marne. Ses terres lui ont été léguées par son père, et il compte transmettre à son tour ce précieux héritage à son fils unique, Paul, de 14 ans.
Depuis un an, pour préparer Paul au métier qui l'attend, Henri l'emmène chaque week-end faire les travaux agricoles. Paul a appris à conduire une moissonneuse-batteuse, et Henri compte bien se servir de cet attrait infantile pour motiver Paul à persévérer dans son apprentissage.
Pendant cinq mois, Paul se lève aux aurores, le samedi et le dimanche, pour aller travailler dans les champs. Une réelle complicité père-fils s'installe entre Henri et Paul ; ce dernier ne parle que d'agriculture durant les repas familiaux, à tel point que Henri envisage de le rediriger en classe agronomique spécialisée.
Mais cette réorientation scolaire a aussi d'autres motifs, bien moins joyeux. En effet, les résultats de Paul baissent considérablement depuis que son père l'a entraîné dans la passion de l'agriculture.
Lors d'une réunion parents-professeurs, la mère de Paul apprend de son professeur principal que ses notes en français, anglais et maths sont très médiocres. C'est uniquement en éducation physique que Paul arrive à se démarquer.
En rentrant à la maison, la femme de Henri informe son mari des piètres performances de son fils. En apprenant la nouvelle, Henri ordonne à Paul de monter dans sa chambre et d'en ressortir uniquement pour dîner. Paul s'y précipite en sanglotant.
Trois heures plus tard, Henri va chercher Paul pour qu'il vienne à table. Mais, en essayant de tourner la poignée, Henri s'aperçoit que la porte est bloquée de l'intérieur. Il appelle son fils, mais cela reste sans réponse. Il réussit finalement à entrer et s'aperçoit qu'une chaise coinçait la poignée. De l'autre côté de la pièce, la fenêtre est grande ouverte. Henri redescend en courant avertir sa femme que leur enfant a fugué. Ils sortent alors tout deux dehors, et après avoir crié le nom du jeune garçon dans tous les coins de leur jardin pendant un bon quart d'heure, ils décident de prendre chacun une voiture pour partir à sa recherche à travers champs.
Monsieur Edwards, tout au bout du champ de betteraves, trouve son fils, assis, en train de récolter des petits cailloux dans sa main puis de les jeter devant lui, un à un.
Monsieur Edwards arrête la voiture, sort et prend son fils par le bras pour l'emmener chez eux. Durant le trajet de retour, l'enfant est silencieux. Dès qu'ils sont rentrés, Monsieur Edwards dîne avec son enfant en attendant sa mère.
Durant le dîner, l'enfant ne fait que parler de sa mère, sans interruption. A 22h, Monsieur Edwards lui dit d'aller se coucher pendant que lui veille pour attendre le retour de sa femme.
Le lendemain, Paul se réveille et va prendre son petit déjeuner. Il trouve son père assis sur le canapé, les traits tirés par la nuit blanche qu'il vient de passer. Monsieur Edwards est tiré de son état somnolent par son enfant qui le pousse dans la cuisine pour qu'il lui prépare son petit déjeuner.
Puis, Paul s'habille et demande à son père l'autorisation d'aller se balader dans les champs avant de partir à l'école. Enthousiasmé que son enfant ait repris goût pour la campagne, Monsieur Edwards accepte. Paul part alors en courant. Pendant ce temps-là, Monsieur Edwards appelle la police pour signaler la disparition de sa femme. Paul rentre pour l'heure de l'école. Son père va le poser, puis va au commissariat du village pour proposer son aide concernant les démarches faites pour trouver sa femme. Monsieur Edwards passe sa journée au commissariat. En fin d'après-midi, il retourne chez lui et fait un crochet par l'école pour récupérer son fils. Pendant la soirée, Monsieur Edwards se tient près du téléphone, prêt à recevoir la moindre nouvelle de sa femme. Paul va se coucher pendant que son père reste pour veiller.
Le lendemain matin, Paul, en descendant petit-déjeuner, aperçoit son père endormi sur le canapé. Ce dernier se réveille en sursaut pour accueillir son fils. Puis, Paul s'habille et demande à son père l'autorisation d'aller se balader dans les champs avant de partir à l'école. Enthousiasmé que son enfant ait repris goût pour la campagne, Monsieur Edwards accepte.
Paul tarde à rentrer. Alors, tandis que l'heure de l'école approche, Monsieur Edwards sort dans les champs en voiture pour aller récupérer Paul. Celui-ci est l'autre bout du même champ de betterave en train de parler à une forme féminine. En voyant cela Monsieur Edwards appuie sur l'accélérateur, mais la fille l'a aperçu de loin et saute dans les fourrés.
Paul va dans la voiture de son père. Ce dernier, affolé, lui demande qui était cette personne. Paul lui dit avoir cru que c'était « maman ». Henri emmène son fils à l'école sans lui poser plus de questions. Puis il va au commissariat pour parler aux représentants de l'ordre de l'apparition mystérieuse avec laquelle son fils a discuté. Les gendarmes mettent en garde Monsieur Edwards contre les vagabonds qui rôdent dans le coin et lui suggère d'éviter que son fils sorte seul dans les champs.
Une journée passe. Monsieur Edwards fait des réparations sur les machines servant aux travaux agricoles, puis va chercher son fils et l'emmène dîner dans un petit bistrot, pensant que cela lui fera oublier, l'espace d'un moment, les déboires des derniers jours. Le repas se passe agréablement, agrémenté de conversations sur la date des récoltes, et de nouvelles de l'école. Au moment de payer, des gendarmes font irruption dans le troquet, paient à la place de Monsieur Edwards et lui demandent de les suivre. Ils disent avoir retrouvé sa femme, elle attend Monsieur Edwards et son garçon au commissariat. Père et fils suivent les gendarmes en voiture.
La femme de Monsieur Edwards est assise à une table, dans la pièce principale. Monsieur Edwards et Paul se précipitent vers elle et l'embrassent en pleurant.
Elle leur raconte alors que, pendant ses recherches, la voiture était tombée en panne. Elle est alors sortie pour voir ce qui n'allait pas sous le capot. Là, on l'a frappée à la tête et elle est tombée évanouie. Elle s'est réveillée en rase campagne, à la tombée du jour, et a ensuite marché pendant trois heures à peu près, espérant tomber sur une personne pouvant lui indiquer la route à suivre pour rentrer au village. Vers 11h du soir, raconte-t-elle, elle rencontre une fille d'à peu près 18 ans au bord d'une route déserte. Elle a une allure négligée, ses vêtements sont déchirés et elle n'arrive pas à se tenir droite. Intimidée, la fille à l'allure vagabonde lui demande ce qu'elle fait ici. La femme de Monsieur Edwards lui raconte l'histoire, et lui demande son nom. La fille à l'allure vagabonde s'appelle Julia. Elle lui dit qu'elle est partie de là où elle vivait pour faire de la route. La femme de Monsieur Edwards demande la direction du plus proche village à Julia. Julia pointe le doigt vers sa droite, puis serre la main de Madame Edwards en lui souhaitant bonne chance. Reprenant courage, elle marche d'un pas résolu vers la direction que lui a montrée Julia. Mais, après une bonne demi-heure de marche, elle s'aperçoit qu'elle s'éloigne complètement de tout signe de civilisation. Il n'y a plus que la campagne qui s'étend à perte de vue. Elle décide alors de rebrousser chemin. Elle repasse là où elle a rencontrée Julia, mais cette dernière n'est plus là. Madame Edwards dit à sa famille qu'elle a encore marché pendant quelques heures avant de tomber sur les premières habitations. Alors elle a toqué à la première porte, et racontée au habitants ses déboires. Eux ont jugés bons de la laisser dormir dans une chambre, puis, après son sommeil, de l'emmener au commissariat de son village.
Monsieur Edwards, ne voulant pas importuner sa femme plus que ça, l'emmène à la maison sans lui poser plus de questions. Ils dînent silencieusement puis vont se coucher.
Le lendemain matin, premier jour du week-end, Monsieur Edwards et son fils vont dans les champs pour labourer. Un grand soleil perdure pendant toute la journée.
En fin d'après-midi, les deux hommes de la maison s'arrêtent de travailler et proposent à Madame Edwards de venir boire une limonade à l'ombre des arbres, dans le jardin. Henri dit à son fils d'aller jouer plus loin, et en profite pour questionner sa femme sur l'aventure qui lui est arrivée. Dès qu'il aborde le sujet, elle devient tremblante, a du mal à rester assise sur sa chaise et finit chacune de ses phrases en bredouillant. Ne voulant pas mettre mal à l'aise sa femme, il abandonne le sujet.
Au dîner, Monsieur Edwards aborde de nouveau la question, cette fois en présence de leur fils. On peut voir s'inscrire sur le visage de Madame Edwards le même malaise que lors de leur dernière conversation. Elle avoue que ses souvenirs sont assez confus. En fin de soirée, lorsque Paul est couché, Monsieur Edwards propose à sa femme de l'emmener le lendemain voir un psychiatre pour l'aider à se débarrasser du traumatisme causé par l'incident. Elle accepte.
Le lendemain, Monsieur Edwards trouve le numéro d'un psychiatre dans le bottin et l'appelle avant de partir au travail. Il convient d'une consultation pour 15h. Madame Edwards part seule au rendez-vous. Elle revient chez les Edwards quatre heures après. Le père vient juste de rentrer des champs et Paul est revenu de l'école avec le bus scolaire. Durant le dîner, Madame Edwards reste prostrée dans un mutisme catatonique et ne répond ni à son fils ni à son mari. Très inquiet, ce dernier va la conduire dans son lit, pensant qu'elle a besoin de repos.
Au beau milieu de la nuit, celle-ci sort de son lit en hurlant, puis court jusqu'au rez-de-chaussée. Elle s'assoit alors sur le canapé, et se rendort presque instantanément. Monsieur Edwards, bien que surpris au début, conclut à une simple crise de somnambulisme.
Les jours suivants, Madame Edwards paraît de plus en plus stressée. Elle ne parle plus à son fils et lui lance, quelque fois, des regards de défis. A son mari, elle porte beaucoup de regards enamourés, mais sans jamais lui adresser la parole si ce n'est pour dire « bonjour » et « bonsoir ». La veille du week-end, son mari la conjure de retourner pour quelques séances chez le psychiatre. Madame Edwards agrée en maugréant.
Elle quitte la maison le vendredi après-midi, disant qu'elle a un rendez-vous avec le psychiatre, et rentre en début de soirée. La soirée se passe sans incidents.
Le lendemain matin, Monsieur Edwards se réveille et ne trouve pas sa femme à côté de lui, dans le lit. Il s'habille et fait le tour de la maison en l'appelant. Il va même jusqu'à sortir de la propriété. Il fait quelques pas sur la route voisine, et aperçoit sa femme allongé en plein milieu. Elle est ensanglantée. Il se précipite et s'accroupit devant elle pour lui prendre son pouls. Au même moment, il entend derrière lui le gueulement d'une voiture qui démarre en trombe.
Depuis un an, pour préparer Paul au métier qui l'attend, Henri l'emmène chaque week-end faire les travaux agricoles. Paul a appris à conduire une moissonneuse-batteuse, et Henri compte bien se servir de cet attrait infantile pour motiver Paul à persévérer dans son apprentissage.
Pendant cinq mois, Paul se lève aux aurores, le samedi et le dimanche, pour aller travailler dans les champs. Une réelle complicité père-fils s'installe entre Henri et Paul ; ce dernier ne parle que d'agriculture durant les repas familiaux, à tel point que Henri envisage de le rediriger en classe agronomique spécialisée.
Mais cette réorientation scolaire a aussi d'autres motifs, bien moins joyeux. En effet, les résultats de Paul baissent considérablement depuis que son père l'a entraîné dans la passion de l'agriculture.
Lors d'une réunion parents-professeurs, la mère de Paul apprend de son professeur principal que ses notes en français, anglais et maths sont très médiocres. C'est uniquement en éducation physique que Paul arrive à se démarquer.
En rentrant à la maison, la femme de Henri informe son mari des piètres performances de son fils. En apprenant la nouvelle, Henri ordonne à Paul de monter dans sa chambre et d'en ressortir uniquement pour dîner. Paul s'y précipite en sanglotant.
Trois heures plus tard, Henri va chercher Paul pour qu'il vienne à table. Mais, en essayant de tourner la poignée, Henri s'aperçoit que la porte est bloquée de l'intérieur. Il appelle son fils, mais cela reste sans réponse. Il réussit finalement à entrer et s'aperçoit qu'une chaise coinçait la poignée. De l'autre côté de la pièce, la fenêtre est grande ouverte. Henri redescend en courant avertir sa femme que leur enfant a fugué. Ils sortent alors tout deux dehors, et après avoir crié le nom du jeune garçon dans tous les coins de leur jardin pendant un bon quart d'heure, ils décident de prendre chacun une voiture pour partir à sa recherche à travers champs.
Monsieur Edwards, tout au bout du champ de betteraves, trouve son fils, assis, en train de récolter des petits cailloux dans sa main puis de les jeter devant lui, un à un.
Monsieur Edwards arrête la voiture, sort et prend son fils par le bras pour l'emmener chez eux. Durant le trajet de retour, l'enfant est silencieux. Dès qu'ils sont rentrés, Monsieur Edwards dîne avec son enfant en attendant sa mère.
Durant le dîner, l'enfant ne fait que parler de sa mère, sans interruption. A 22h, Monsieur Edwards lui dit d'aller se coucher pendant que lui veille pour attendre le retour de sa femme.
Le lendemain, Paul se réveille et va prendre son petit déjeuner. Il trouve son père assis sur le canapé, les traits tirés par la nuit blanche qu'il vient de passer. Monsieur Edwards est tiré de son état somnolent par son enfant qui le pousse dans la cuisine pour qu'il lui prépare son petit déjeuner.
Puis, Paul s'habille et demande à son père l'autorisation d'aller se balader dans les champs avant de partir à l'école. Enthousiasmé que son enfant ait repris goût pour la campagne, Monsieur Edwards accepte. Paul part alors en courant. Pendant ce temps-là, Monsieur Edwards appelle la police pour signaler la disparition de sa femme. Paul rentre pour l'heure de l'école. Son père va le poser, puis va au commissariat du village pour proposer son aide concernant les démarches faites pour trouver sa femme. Monsieur Edwards passe sa journée au commissariat. En fin d'après-midi, il retourne chez lui et fait un crochet par l'école pour récupérer son fils. Pendant la soirée, Monsieur Edwards se tient près du téléphone, prêt à recevoir la moindre nouvelle de sa femme. Paul va se coucher pendant que son père reste pour veiller.
Le lendemain matin, Paul, en descendant petit-déjeuner, aperçoit son père endormi sur le canapé. Ce dernier se réveille en sursaut pour accueillir son fils. Puis, Paul s'habille et demande à son père l'autorisation d'aller se balader dans les champs avant de partir à l'école. Enthousiasmé que son enfant ait repris goût pour la campagne, Monsieur Edwards accepte.
Paul tarde à rentrer. Alors, tandis que l'heure de l'école approche, Monsieur Edwards sort dans les champs en voiture pour aller récupérer Paul. Celui-ci est l'autre bout du même champ de betterave en train de parler à une forme féminine. En voyant cela Monsieur Edwards appuie sur l'accélérateur, mais la fille l'a aperçu de loin et saute dans les fourrés.
Paul va dans la voiture de son père. Ce dernier, affolé, lui demande qui était cette personne. Paul lui dit avoir cru que c'était « maman ». Henri emmène son fils à l'école sans lui poser plus de questions. Puis il va au commissariat pour parler aux représentants de l'ordre de l'apparition mystérieuse avec laquelle son fils a discuté. Les gendarmes mettent en garde Monsieur Edwards contre les vagabonds qui rôdent dans le coin et lui suggère d'éviter que son fils sorte seul dans les champs.
Une journée passe. Monsieur Edwards fait des réparations sur les machines servant aux travaux agricoles, puis va chercher son fils et l'emmène dîner dans un petit bistrot, pensant que cela lui fera oublier, l'espace d'un moment, les déboires des derniers jours. Le repas se passe agréablement, agrémenté de conversations sur la date des récoltes, et de nouvelles de l'école. Au moment de payer, des gendarmes font irruption dans le troquet, paient à la place de Monsieur Edwards et lui demandent de les suivre. Ils disent avoir retrouvé sa femme, elle attend Monsieur Edwards et son garçon au commissariat. Père et fils suivent les gendarmes en voiture.
La femme de Monsieur Edwards est assise à une table, dans la pièce principale. Monsieur Edwards et Paul se précipitent vers elle et l'embrassent en pleurant.
Elle leur raconte alors que, pendant ses recherches, la voiture était tombée en panne. Elle est alors sortie pour voir ce qui n'allait pas sous le capot. Là, on l'a frappée à la tête et elle est tombée évanouie. Elle s'est réveillée en rase campagne, à la tombée du jour, et a ensuite marché pendant trois heures à peu près, espérant tomber sur une personne pouvant lui indiquer la route à suivre pour rentrer au village. Vers 11h du soir, raconte-t-elle, elle rencontre une fille d'à peu près 18 ans au bord d'une route déserte. Elle a une allure négligée, ses vêtements sont déchirés et elle n'arrive pas à se tenir droite. Intimidée, la fille à l'allure vagabonde lui demande ce qu'elle fait ici. La femme de Monsieur Edwards lui raconte l'histoire, et lui demande son nom. La fille à l'allure vagabonde s'appelle Julia. Elle lui dit qu'elle est partie de là où elle vivait pour faire de la route. La femme de Monsieur Edwards demande la direction du plus proche village à Julia. Julia pointe le doigt vers sa droite, puis serre la main de Madame Edwards en lui souhaitant bonne chance. Reprenant courage, elle marche d'un pas résolu vers la direction que lui a montrée Julia. Mais, après une bonne demi-heure de marche, elle s'aperçoit qu'elle s'éloigne complètement de tout signe de civilisation. Il n'y a plus que la campagne qui s'étend à perte de vue. Elle décide alors de rebrousser chemin. Elle repasse là où elle a rencontrée Julia, mais cette dernière n'est plus là. Madame Edwards dit à sa famille qu'elle a encore marché pendant quelques heures avant de tomber sur les premières habitations. Alors elle a toqué à la première porte, et racontée au habitants ses déboires. Eux ont jugés bons de la laisser dormir dans une chambre, puis, après son sommeil, de l'emmener au commissariat de son village.
Monsieur Edwards, ne voulant pas importuner sa femme plus que ça, l'emmène à la maison sans lui poser plus de questions. Ils dînent silencieusement puis vont se coucher.
Le lendemain matin, premier jour du week-end, Monsieur Edwards et son fils vont dans les champs pour labourer. Un grand soleil perdure pendant toute la journée.
En fin d'après-midi, les deux hommes de la maison s'arrêtent de travailler et proposent à Madame Edwards de venir boire une limonade à l'ombre des arbres, dans le jardin. Henri dit à son fils d'aller jouer plus loin, et en profite pour questionner sa femme sur l'aventure qui lui est arrivée. Dès qu'il aborde le sujet, elle devient tremblante, a du mal à rester assise sur sa chaise et finit chacune de ses phrases en bredouillant. Ne voulant pas mettre mal à l'aise sa femme, il abandonne le sujet.
Au dîner, Monsieur Edwards aborde de nouveau la question, cette fois en présence de leur fils. On peut voir s'inscrire sur le visage de Madame Edwards le même malaise que lors de leur dernière conversation. Elle avoue que ses souvenirs sont assez confus. En fin de soirée, lorsque Paul est couché, Monsieur Edwards propose à sa femme de l'emmener le lendemain voir un psychiatre pour l'aider à se débarrasser du traumatisme causé par l'incident. Elle accepte.
Le lendemain, Monsieur Edwards trouve le numéro d'un psychiatre dans le bottin et l'appelle avant de partir au travail. Il convient d'une consultation pour 15h. Madame Edwards part seule au rendez-vous. Elle revient chez les Edwards quatre heures après. Le père vient juste de rentrer des champs et Paul est revenu de l'école avec le bus scolaire. Durant le dîner, Madame Edwards reste prostrée dans un mutisme catatonique et ne répond ni à son fils ni à son mari. Très inquiet, ce dernier va la conduire dans son lit, pensant qu'elle a besoin de repos.
Au beau milieu de la nuit, celle-ci sort de son lit en hurlant, puis court jusqu'au rez-de-chaussée. Elle s'assoit alors sur le canapé, et se rendort presque instantanément. Monsieur Edwards, bien que surpris au début, conclut à une simple crise de somnambulisme.
Les jours suivants, Madame Edwards paraît de plus en plus stressée. Elle ne parle plus à son fils et lui lance, quelque fois, des regards de défis. A son mari, elle porte beaucoup de regards enamourés, mais sans jamais lui adresser la parole si ce n'est pour dire « bonjour » et « bonsoir ». La veille du week-end, son mari la conjure de retourner pour quelques séances chez le psychiatre. Madame Edwards agrée en maugréant.
Elle quitte la maison le vendredi après-midi, disant qu'elle a un rendez-vous avec le psychiatre, et rentre en début de soirée. La soirée se passe sans incidents.
Le lendemain matin, Monsieur Edwards se réveille et ne trouve pas sa femme à côté de lui, dans le lit. Il s'habille et fait le tour de la maison en l'appelant. Il va même jusqu'à sortir de la propriété. Il fait quelques pas sur la route voisine, et aperçoit sa femme allongé en plein milieu. Elle est ensanglantée. Il se précipite et s'accroupit devant elle pour lui prendre son pouls. Au même moment, il entend derrière lui le gueulement d'une voiture qui démarre en trombe.
WALKÜRIE RÖDEÖ
Ces pin-ups ont la particularité d’avoir leur œil à l’intérieur d’un tube, lorsqu’une menace s’approche l’œil sort en s’invaginant avec une telle violence qu’il aspire le prédateur en son sein, avant de refermer sa surface sans une seule soudure résiduelle. Bouffi au bout du tube, la substance oculaire se contractant si fort pour broyer l’aliment que la pupille semble se lever par spasmes, l’œil ne peut redescendre qu’une fois la digestion terminée et comme il ne possède pas d’anus il s’ouvre à nouveau plusieurs fois et rejette. Certaines ont les yeux si ronds qu’ils peuvent rouler de leurs tubes et circuler en dehors.
*
**
**
Des quatre rues qui convergent sur la place arrivent des chars, les CRS sortent leurs scabies-ball. Le fusil tire des scabies qui déterminent une gale en creusant dans l’épiderme des galeries où elles déposent leurs œufs : à ses points de rassemblement la foule brusquement dégoûtée par quelques congénères galés s’en recule et s’éparpille.
*
**
**
Les pin-ups survolent en Harley-Davidson la manifestation, du bout de leur lance elles désignent ceux qui ont les plus beaux culs ou la langue la plus rapide, le nuage de gaz lacrymogène traversé par leur laser pour y former un canal d’air conducteur et, une fraction de seconde après, une puissante mort est envoyée vers la cible à travers ce canal. Les meilleurs tombent. Brûlés, perforés, matraqués, scabiesés, bidouillés du poumon ou égorgés, grenadés. Lorsque les ailes de sa moto s’écartent pour accrocher l’air ferme autour d’elle la jeune demoiselle vient se poser, son enveloppe charnelle serre si étroitement la force qui est en elle qu’elle semble prête de craquer et libérer un char d’assaut ou un jet, pourtant elle s’agenouille aux côtés du révolutionnaire mort, appose sa paume sur son front qu’elle relève, sans effort ni appui, et entraîne jusqu’à la moto, qui les emporte.
*
**
**
Je fais le mort. A mon contact la paume se dissout pour se retendre sous mon front. Sa peau s’assemble à une densité venue de mon crâne. Elle m’asseoit sans que j’ai à m’accouder, mais le plus difficile pour moi est d’avancer en glissant sur la pointe des pieds, si le sol reculait, sans essayer de me rattraper et faire un pas.
*
**
**
*
**
**
*
**
**
*
**
**
*
**
**
*
**
**
*
**
**
Do it yourself
Do it yourself
Dans ce temps là ma tête n’avait qu’une seule veine, mon sang coulait avec une si grande force que je ne pouvais m’empêcher de l’accompagner : ratatiner, m’emplir, ratatiner, m’emplir, ratatiner, … je réalisais les secousses qui m’animaient.
*
* *
* *
Lors de son passage toute proie me dévie fortement. Si elle me tourne autour elle va avoir tendance à déformer ma surface et l'entraîner dans sa rotation, jusqu'à me détacher un bout. Ainsi happée par une proie ma matière ne se décale pas sans élasticité et se résorbe à moi plusieurs fois avant d'être engloutie dans l'autre.
*
* *
* *
J’avais un ventre avec la terre, et soulevé de terre. Notre ventre. Par lui le sol me relançait, il repartait de mon corps mais sans moi.
D’entortiller ses galeries la terre m’excave des intestins.
D’entortiller ses galeries la terre m’excave des intestins.
*
* *
* *
Au niveau digestif, le plus souvent ils m’atteignent avec leurs mains (plus rarement à coups de pied ou de dents), ma peau accompagne leur coup en se relâchant dans les autres zones tandis qu’elle se roule en filaments où ils me touchent. Ces émissions s’étirent et se rétractent, ce qui leur permet de me ramper au long de la proie, à force de m’enrouler autour pour l’immobiliser et augmenter la surface de contact entre elle et ma membrane digestive elles m’essorent, appliquant ainsi un film de fines gouttelettes : le film se disperse et se réassemble dans la peau, se mélangeant à l’aliment cette langue le malaxe tout en permettant de m’y ancrer. Lorsqu’il cède sous l’adhésion de ma membrane, par répercussion celle-ci s’invagine, je n’ai plus qu’à ingurgiter : la paroi musculaire se rétrécit puis propulse la portion de langue et de nourriture lentement vers la suite du tube digestif.
*
* *
* *
Du doigt, en me frottant la peau, je parviens à l’excaver. Suffisamment profond le trou suinte de telle sorte que son opercule se réduit sans jamais pouvoir se refermer. Je peux alors m’y incorporer un grain de sable et m’en servir dans la masse du liquide comme balancier, les percussions du grain contre les parois me permettant de déterminer si je monte ou descends un escalier, me penche ou me rétablis. Mais le grain malheureusement constitue un perfectionnement si sensible de mon être qu’il subit des secousses au moindre son, mon sens de l’équilibre prenant le développement d’un organe de l’audition.
Il me faut alors travailler ma stabilité en toutes circonstances d’audition. Par exemple, alors que je me trouve les épaules plongeantes, un hurlement m’étend les deux jambes en coup de frein. Ou encore lorsque d’accélérer je cabre, rejetant tout le poids de mon corps sur mes fesses et la tête fuyant en arrière, le crissement d’un gravier me tire le sol vers le ciel. Il s’agit alors de réduire l’angle qu’ont les fréquences sonores avec les secousses de l’horizontalité, cela me donne moins de plongée mais aussi de cabrage, car de s’égaliser son et équilibre s’appuient mutuellement et allongent la période de suspension entre chaque appel du pied, m’intimant une allure dilatante dans la course, qui n’ajoute pas de pas au pas, mais m’immobilise. Puisque je ne peux évidemment pas accélérer ou détendre la pression à l’intérieur du grain, je modèle mon sexe en le roulant avec les doigts, mais comme je ne parviens pas à suffisamment l’amincir, pour en faciliter l’introduction je dois tirer le pavillon de mon oreille. Dans le conduit le sexe se maintient encore comprimé quelques secondes, avant de s’adapter de lui-même aux parois.
Il me faut alors travailler ma stabilité en toutes circonstances d’audition. Par exemple, alors que je me trouve les épaules plongeantes, un hurlement m’étend les deux jambes en coup de frein. Ou encore lorsque d’accélérer je cabre, rejetant tout le poids de mon corps sur mes fesses et la tête fuyant en arrière, le crissement d’un gravier me tire le sol vers le ciel. Il s’agit alors de réduire l’angle qu’ont les fréquences sonores avec les secousses de l’horizontalité, cela me donne moins de plongée mais aussi de cabrage, car de s’égaliser son et équilibre s’appuient mutuellement et allongent la période de suspension entre chaque appel du pied, m’intimant une allure dilatante dans la course, qui n’ajoute pas de pas au pas, mais m’immobilise. Puisque je ne peux évidemment pas accélérer ou détendre la pression à l’intérieur du grain, je modèle mon sexe en le roulant avec les doigts, mais comme je ne parviens pas à suffisamment l’amincir, pour en faciliter l’introduction je dois tirer le pavillon de mon oreille. Dans le conduit le sexe se maintient encore comprimé quelques secondes, avant de s’adapter de lui-même aux parois.
*
* *
* *
La marmaucha Mudi-esquia - on parle de cette bête (marmaucha) de l’embouchure de l’Adour jusqu’au nord du Marensin lorsqu’on retrouve un cadavre évidé de son échine et certains os ; comme on voit la bête après avoir tué un homme marcher debout, mais galoper quand c’est un cheval, on pense qu’elle emporte les échines pour en changer.
*
* *
* *
Peu après la métamorphose, je gagne la ville : je m’attaque aux voyageurs de préférence en mauvaise condition, en me fixant sur eux par ma bouche. En ventouse avec, à l’intérieur de sa lèvre circulaire, ses rangées concentriques de dents, je perce la peau de ma victime par raclage et suce le sang. Puis la pâte s’approfondit et je pénètre à l’intérieur du corps que je dévore complètement au moyen de ma langue râpeuse. Lorsque le voyageur est affaibli, je me détache et vais en choisir un autre.
*
* *
* *
Pour assimiler ensuite la proie à mon sang, sans trop fatiguer les aires d’échange, j’ai des rehauts. Dans un segment du tube digestif qui contient une abondante quantité de liquide, l’air coince par des spasmes et des coudes ; le procédé consiste à effectuer des rotations du volume intestinal, les gaz cognent alors et dans leur tentative de passage valdinguent l’intestin d’une veine sur l’autre.
*
* *
* *
Ensuite il me pousse des yeux. Les adultes peu après la poussée des yeux se laissent emporter par le courant et meurent.
*
* *
* *
J’en profite pour passer une annonce. Je vends mes os.
Mes os permettent d’atténuer les coups forts, sans endommager leur environnement. Ils s’adaptent à la forme du poing ou des dents, assurant une excellente réception et accompagnant le corps étranger en moi. La texture de mes os, lorsque l’on me coupe, particulièrement lisse et douce, offre un contact agréable et ne procure aucune gène. Ils sont idéaux pour des activités en milieu violent.
Mes os permettent d’atténuer les coups forts, sans endommager leur environnement. Ils s’adaptent à la forme du poing ou des dents, assurant une excellente réception et accompagnant le corps étranger en moi. La texture de mes os, lorsque l’on me coupe, particulièrement lisse et douce, offre un contact agréable et ne procure aucune gène. Ils sont idéaux pour des activités en milieu violent.
*
* *
* *
L’œil tourne en se dédoublant par le milieu, avant de restituer sa pupille sur une position plus centrale. Dans le même orbite les deux sphères se gênent, mutuellement elles se repoussent. Mais sous l’effort de la pupille qui tire dans tous les sens, comme affolée, par un bercement léger, la différence de pression entre les deux globes augmente et crée un appel de substance qui atténue leur ligne de contact et les canalisent, après quelques crispations ne me regarde plus qu’un seul œil. Se maintient un dénivellement du globe oculaire.
Inscription à :
Articles (Atom)