(Photographie d'Anabel Serna Montoya)
J’aime que la poésie garde quelque chose d’inexplicable. J’aime faire le singe en haut des branches plutôt que redescendre sur terre et fournir la réponse qui m’était imposée par votre question. L’écriture n’a pas à être où on la veut. Elle garde en elle une marge incompressible. Regardez-la. Voyez-la clignoter, changer de rythme, quitter le port, affronter Dieu pour retomber l’instant d’après dans un désert, en haut de l’Everest ou sur les mains. Deux vers seulement et trois mondes naissent. Trois vers plus loin, une bonne dizaine. Il n’y a pas d’ordre. Pas de discours posé, pensé, poli par de bien zélés profs logiques. J’aime retrouver au bord des vers ce serein pas savoir, ce serein pas prévoir. Cet instant brèche où se percutent et se font signe en riant les contraires. Du rock d’abord. Ça débute là. On a branché nos vies avec les potes au fond d’une cave. Trafiqué bien dix ans un raffut increvable. De la poésie dans cette foire ? Ce grand bazar de lave gueulée sans respirer jusqu’à l’extase ? Dur à dire. Peut-être oui. Je ne pense pas. Je crois que la poésie, c’est après. C’est quand j’ai commencé à supporter le mot silence. J’ai balancé mon brouhaha au fleuve qui m’a offert des carnets pour écrire sur la route sans arrêt. J’ai rencontré. J’ai écouté. J’ai regardé. J’ai voulu voir. C’était immense et bien trop fort pour moi, le monde. Je cherchais dans les strophes un peu de calme. Et tu te calmais ? Ben non... en sueur, j’enrageais ! Alors pourquoi dis-tu que tu cherchais un peu de calme ? Sale habitude encore qui revient dans les mots. On nous a tellement bourré le mou avec tout ça. Sagesse. Bouddha. Lotus. On va pas un jour arrêter de trimbaler ces vieilleries dans nos sacs ?! Bosnie, Turquie, Hongrie, Pologne, Mexique. Cassoulet sur le Maroni. Pommes de terre/corned-beef au Baïkal. Guitare sèche dans la steppe. Pogo sous un volcan guatémaltèque. Silence en haut de Massada, à dix-huit ans. Baleines soûlardes à Tadoussac. Gnawas fumeurs d’Essaouira et leurs guembris. M’en vais pas faire la liste des lieux, mais ce sont eux, les poèmes, plus que moi. Pas faire non plus la liste des gens, des planètes, animaux, rivières, étoiles, trous noirs, crottes, arbres, mais ce sont eux, les poèmes, plus que moi. Tout ça part d’eux, à chaque instant, à fond la caisse ; je mets mon nom après en bas du texte, mais c’est du vol. Il faudrait signer simplement : LE MONDE, ou plus précisément encore : LA VIE, mais la mort est pour beaucoup dans l’histoire ; elle aussi pousse au cul les flemmards que nous sommes ; au petit jour elle débarque dans nos turnes, nous fait sentir sa gueule un peu et vas-y qu’on RECRACHE DU VERS ! alors tant pis... On saura jamais qui fait quoi, on s’en balance ! On se prolonge ; on se traduit ; on se transmet ; on se récite. On se fait lire à droite, à gauche, aux autres, tout le temps. Voilà ma vision de la poésie : celle d’un sport collectif, une lutte plutôt... une lutte ensemble à mort où il faut faire la passe pour subsister. Un poète pense aux autres ou c’est un gland, y en a beaucoup. Y en a des tas. Des mottes entières de poètes-rats mais qui poussent pas. Qui font pourrir le chêne, c’est pas pareil. Ça n’a même rien à voir. Mais pourquoi perdre des mots à parler d’eux alors qu’on arrive déjà tout au bout de la page ? Parle-nous des loups plutôt et des écorces. Parle-nous des batteurs et des graffeurs libres. Dis-le bien haut que TOUS ENSEMBLE ON FRAPPE PAREIL ! ON BAT PAREIL ! ON CAUSE PAREIL AU VIDE QUI NOUS CHIE DESSUS ! Qu’importe on pue, on doit le faire. On doit continuer le grand tournis à cinq heures du matin, tu y seras ? Un poète fatigué, c’est un poète qu’on a mis en vacances. L’idée de devoir s’arrêter l’épuise. Déjà il fuit dans les calanques. Sue l’inertie. Dégote un tronc et s’y remet à graver dans le bois, murmurer dans la roche, où qu’il pourra. Le vrai papier s’appelle le temps. On écrit là-dessus, sur le temps libre. Quand il s’épuise, on écrit dans nos têtes, en conduisant vers le boulot, ou dans les couches de nos mioches... y a de la place ! Un pare-brise embué peut être un livre. Un carton dans une benne une vraie Pléiade. Tu parles d’un rythme. Tu parles d’un tempo d’acharné au quotidien. D’ailleurs je vais devoir y retourner, pardon les potes. J’ai déjà trop parlé et des rongeurs m’invitent à bouffer leurs noisettes. Sûr qu’ils auront quelques vers à me refiler, les cons ! Je ne peux pas les laisser partir comme cela ! Retrouvons-nous aux alentours de 17h dans l’improbable... D’ici là, quartier libre. Boussole au clou. Oubliez-moi.
Laurent Bouisset, Marseille, été 2017
Plus d'infos ici : https://fuegodelfuego.blogspot.fr/2017/10/duo-bouisset-charbonnier-presentation.html
et là :



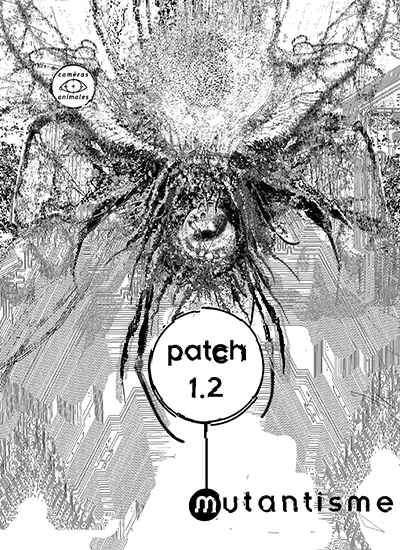


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire