Nora Neko partage avec nous une réflexion sur les liens entre fête et art, et c'est au passage un témoignage sur l'expérience, l'aventure, qu'est le lieu Asile 404 à Marseille.
L’art comme débordement de la fête vers le monde, la fête comme place de l'art
Enfant, j’ai vu un film sur Picasso, l’œil fou, peignant sur une vitre, de l’autre côté de la caméra. On me parlait aussi de Van Gogh, que j’imaginais, comme un brahmane solitaire, passer ses journées dans des coins perdus sans parler à quiconque, sans bouger de sa toile… Et il y avait Raquel, ex-femme de mon père qui me gardait souvent et qui peignait des heures durant des monochromes de 4 mètres de haut, silencieusement et avec une concentration religieuse. L’art était pour moi tout ce qu’il y a de plus sérieux, n’importe quelle blague de surréaliste semblait nécessiter des dizaines de livres pour être comprise, et même mon premier contact avec la performance (happening sanglant dans une galerie, alors que j’avais 13 ans) ne m’a pas du tout fait penser à la fête.
La fête c’est plutôt le mot que j'utilise quand, à force d’échanges verbaux tous azimuts avec des gens, de danse et de musique, de drogues parfois, d’émotions charnelles souvent, quelque chose en moi s’illumine, le monde devient alors léger et aimable, la beauté des gens transparaît à travers leur laideur et, sans faire rien de plus, nous fabriquons quelque chose, quelque chose de tangible entre nous.
Pour atteindre cet état de plaisir, bien des gens se professionnalisent : organiser des teufs dans la campagne avec ce qu’il faut d’ingénierie technique pour tout faire fonctionner, se faire prêter des belles maisons pour des garden-party sauvages, jouer au chat et à la souris avec les autorités, inviter savamment les gens qui vont favoriser la bonne alchimie collective, passer la musique qui va entrer en résonance avec l’humeur présente d’une foule, accompagner les abuseurs de tout dans leurs bons et mauvais délires… sont des savoirs-faire dont l’absence se fait tout de suite sentir.
Une bonne ou une mauvaise fête est ensuite toujours contée, par et entre ceux qui l’ont vécue, afin qu’elle se fige dans la mémoire, que les photos, insignifiantes pour les absents, deviennent les supports à histoire attestant que la fête était réussie, ou foireuse, ou riche en aventures… que la fête était. Puis seules les photos demeurent, associées à une vague sensation agréable, une sensation floue de « présent vivant » déjà passée, incomparable de fait avec la précédente ou la suivante.
Pourtant, ce rapport à la récréation-consommation (prendre de tout et beaucoup, vouloir faire l’amour dans les toilettes à des inconnus, dépenser l’argent férocement, faire des déclarations d’amour à des rivaux, engueuler ses amis, pleurer...) ouvre des possibilités de débordement. Le monde que l’on entrevoit alors : gens qui s’étreignent heureux comme des enfants, corps lâchés jusqu’à l'épuisement, esprits ouverts à l’absurde, à l’étrange, à l’inconséquence, au partage, détails familiers et pourtant nouveaux dans l’environnement, paysages, couleurs, sons, lumières d’une singularité sans mots (fut-ce le plafond d’une cuisine), une temporalité distendue qui sent l’éternel… propose un état souverain oserais-je dire en pensant à Bataille (même si ce qu’il met derrière ce terme est plus compliqué que ça). Un état que l’on aimerait bien connaître dans l’autre dimension du monde.
Les ingrédients qui fabriquent la fête sont ceux qui l’effacent : l’alcool, les regrets d’avoir dit oui d’avoir dit non, de ne plus rien se rappeler, les redescentes et contrecoups psycho-physiologiques divers appellent au retour à la normale, proposant fatalement un schéma d’addition salée : le prix à payer pour avoir lâché quelques heures, quelques jours, quelques années, les rênes du contrôle. Ainsi, comme pour le jeu, tel que Caillois [1] en parle (un espace hétérotopique qui s’oppose au « sérieux »), la fête, dans son amnésie, ne fait peut-être que renforcer la légitimité de ce qui l’entoure : la société « sérieuse » et astreignante, voire aliénante : (l’argent au centre de tout, les villes remplies de passants anonymes, bougons et craintifs, le gris du monde dont on se sent victime ou pire, complice). La fête sait faire oublier cela, c’est son premier rôle, comme le carnaval, comme le foot, comme la guerre, comme toute forme de communion, comme tout rituel expiatoire, souhaité ou subi...
Au lycée, Duchamp m’avait séduit avec « les regardeurs qui font les tableaux » : acception où l’art serait (à l’instar de la Force) ce qui "circule" entre le regardeur et le tableau. A l’instar d’un dieu il serait donc partout pour qui le reconnaît, pour qui a éprouvé une émotion consécutive au contact : trouble ou choc esthétique, vertige de la question sans réponse. L’art n’a donc pas forcément besoin d’oeuvre ni même d’artiste (le chant du frigo, la distorsion des rochers à travers l’eau de mer, les éclairs, la mue des cigales…) mais l’artiste est un participant possible à ce processus naturel en initiant, pour lui-même ou pour autrui, ledit choc, émotion, trouble esthétique… Seul le regardeur est impératif, c’est lui la matière première de l’oeuvre, une matière humaine. Cette idée qui paraît si simple a mûri de longues années avant que je puisse en éprouver une quelconque illustration.
Avant de créer l’Asile 404, j’ai travaillé sur un festival de films maison (micro-formats de moins d’une minute !) pour lequel quiconque voulait assister à la projection devait créer son propre film. Il s’agissait du Cappuccino Long Street Festival [2], dont le texte d’introduction commençait ainsi : « Trop souvent l’énergie de la fête se termine avec les lumières du jour sans laisser autre trace qu’un léger mal de tête. Comment aller plus loin dans la rencontre ? »
Ici pas d’ambition déclarée de produire des œuvres d’art, encore moins des œuvres d’art-vidéo. Il s’agissait plutôt de mettre le maximum de gens en situation de réalisateurs, de leur faire traverser le trouble magique que l’on éprouve pendant les tournages de films, particulièrement les œuvres de fiction, ou l’on répète une scène plusieurs fois, où l’on modifie le réel juste avec un cadre et un éclairage (rarement plus avec ces productions sans budget, parfois filmées au téléphone pas cher). Les soirées de projection étaient des mises en scène, parfois un peu sadiques à l’encontre des publics-participants, où ils devaient répondre à des faux questionnaires hyper-détaillés, affronter des faux comités de censure, des faux experts juridiques… mises en scène qui servaient à créer la tension nécessaire pour rendre sacré le moment de la projection. Les gagnants étaient choisis à l’applaudimètre et ensuite lapidés par le public avec toutes sortes de projectiles. Chaque édition comptait entre 50 et 70 films et l'ambiance particulière de chaque soirée était pour le moins fervente. Les films étaient (sont encore) répertoriés sur un site où se côtoient sans scrupules d’infâmes nullités et des petits chefs-d’oeuvre. Ils sont, en réalité, une simple trace de que qui faisait oeuvre dans ce projet : tous les films ensemble, avec cette tension dans le public, la création dans le détail d’une atmosphère "artificielle".
L’Asile 404 était un pas de plus vers cette démarche. Il s’agissait de créer, dans un quartier populaire, un atelier ayant pignon sur rue afin de faire des passants, voisins, usagers du quartier, les cobayes et la matière constituante d’œuvres in situ, toutes disciplines confondues. Il fallait que des performances hyper-pointues, de la musique expérimentale, des films d’art, des conférences, bref des propositions actuelles et audacieuses puissent être présentées à des gens qui n’ont jamais étudié l’art, qui ne vont pas au musée ou dans les galeries, qui ne savent pas à quoi ça sert et qui s’en fichent bien. Tout reposait sur le fait que tout le monde devait s’y sentir chez soi pour que la perméabilité soit totale et que de ces rencontres, émerge non pas de la culture mais rien de moins qu’une envie commune de re-regarder le monde.
Après trois ans d’existence, l’Asile a éprouvé une expérience pleine de nuances vis-à-vis de cette ambition et il s’avère que ce n’est pas lors des innombrables vernissages, ateliers ouverts, classes pour enfants que les choses se sont enclenchées mais bel et bien dans les fêtes, qu’elles soient dehors en pleine journée comme lors des Fêtes de l’Œil [3] ou plus fréquemment le soir, c’est la dimension festive qui a su réunir des gens différents, leur donner le temps de se rencontrer, d’établir des codes sociaux souples, spécifiques à cet espace, d’émuler ensemble jusqu’à oublier complètement qui sont les artistes dans l’histoire. A présent tous nos vernissages sont en soirée, durent tard, accueillent les gens qui soudainement, entre un concert et une fin de nuit incertaine, se perdent dans nos murs et s’arrêtent une heure devant une toile, un film, s’engouffrent dans un espace clos sans savoir ce qui les y attend, car plus l’heure tourne, moins elle compte.
Un souvenir précis que j’espère explicite : La douche [4], une oeuvre de Marine Debilly-Cerisier. Il s’agissait d’une simple douche carrée, dans un coin de la salle face à l’entrée. Elle protégeait son coupant par le moyen d’un rideau en plastique totalement transparent. En journée, les visiteurs regardaient l’objet comme une sculpture, voire simplement comme une douche résultant d’une transformation d’espace inachevée. Le soir, après une heure de concert dans une salle surchauffée, les aspirants à une douche fraîche devenaient plus nombreux et surtout un peu moins timides. Certains des nombreux usagers de cette douche ont gardé leur vêtements, tout ou partie, mais la plupart des hommes et femmes qui se sont douchés ont joué le jeu et fait ainsi exister l’oeuvre. Certains visiteurs diurnes en la voyant éteinte, dans un espace calme et éclairé ont eu un rictus de mépris en voyant là une pâle référence à l’Urinoir, et ils ont sans doute raison. Cette douche marchait. Éteinte, elle était comme un instrument de musique posé au sol : une référence conceptuelle, intellectuelle à la musique pour ceux qui en connaissent l’usage. Une fois mise en marche par quelqu'un, elle fait oeuvre : tout le monde comprend la double dimension intime/scénique de l’objet-douche (de toutes les douches du monde). Elle crée également une narration pour les spectateurs en imposant une véritable performance pour chaque usager qui à la fois doit se montrer et oublier qu’il est regardé, et enfin, surtout, elle fabrique une ambiance précise et fragile dans la foule... Rue d’Aubagne, 1h du matin, les gens sont ivres, des filles nues passent parmi eux en se séchant, aucun geste déplacé, aucune remarque motivée par autre chose que la camaraderie. Tout le monde entrevoit un instant la valeur de cette douce intimité partagée avec des inconnus (inconnus comprenant notamment quelques ivrognes célibataires pas forcément toujours respectueux des femmes, avec qui créer une tel climat, une telle secousse des rapports sociaux relève possiblement de l’exploit).
De cette accumulation d’expériences collectives, où la fête, phénomène ancestral voire ante-humain, brouille ainsi les notions historiques d’oeuvre, d’artiste, de public, émergera peut-être de nouveaux regardeurs, pas de ceux qui s’intéressent à l’art, de ceux qui savent le faire exister quand l’occasion se présente, c’est à dire bien au-delà des lieux d’art. Comme Lars Von Trier qui, dans Idioten, renvoie chacun faire l’idiot dans son propre monde pour mieux le renverser, je compte avec espoir sur cette forme d’art (non pas ce qui est à voir mais ce qui a été vécu et absorbé) pour contaminer, esthétiquement et donc politiquement, le réel autant que son double [5].
Nora Neko, le 18.08.2015
1. Roger Caillois, Des jeux et des hommes : sur les rapports entre la fête et le jeu il y aurait beaucoup à dire.
4. Marine Debilly-Cerisier, La douche, scénographie du banal (2014)
5. Clément Rosset, Le réel et son double








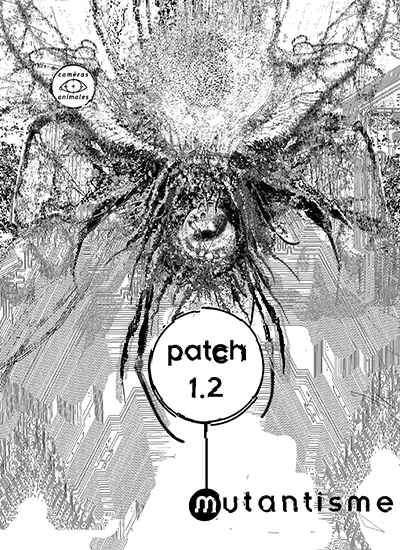


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire