Mon fils reposa son bol de lait sur la table de la cuisine, renifla, et me demanda de son air le plus malicieux quel était mon rôle dans cette histoire. J’avais déserté le grand cirque pour écrire des romans noirs torpillant les lunettes roses. Mon voisin d‘en face choisit ce même jour pour me saluer. En deux ans de face à face, c’était bien la première fois qu’il daignait m’honorer de son attention. Il tenait dans ses mains mon dernier roman, « Plaisirs Nocturnes », et me confessa que mes mots avaient remplacé les siens. Quelle surprise de découvrir le son de sa voix. Dédicace en poche, il s’empressa de regagner son domicile, sans me perdre des yeux.
Je relevais une déformation sur son visage, la bouche nerveuse, du genre à se bouffer secrètement les dents des nuits durant, et toujours ce chapeau en désaccord total avec sa ligne vestimentaire. Exactement le style d’homme d’un autre temps qui venait d’atterrir dans l’intrigue de mon prochain livre, au moment où l’histoire prenait une tournure inattendue. Il portait un de ces chapeaux des années cinquante dont la coupe me fascinait, sûr qu’à l’époque de la démocratisation de la robotique et des intelligences artificielles, il gardait une sorte de machine à écrire old school dans son grenier et s’amusait parfois à jouer aux écrivains de roman de gare, à l’ancienne, clope au bec, et mauvais bourbon dans les circuits quand sa femme le lâchait pour quelque visite hebdomadaire à son club de gymnastique ou une réunion sextoys avec les copines.
Sur le chemin de l’école, une forme assez suspecte de synchronicité m’épingla sur ces traces. Je ne puis que lui emboîter le pas. L’absurdité de la situation ne me sauta aux yeux que bien plus tard. Cette filature avait la saveur d’une scène de polar en noir et blanc. Le réservoir était plein, l’autoradio alimenté en classiques rock du vingtième siècle, j’avais le temps de voir venir les choses, loin d’imaginer qu’il allait rouler en boucle tout au long de la journée, jusqu’à ce qu’il s’arrête sur le parking d’un hypermarché. L’ordinateur de bord de ma voiture afficha alors le tracé récapitulatif du parcours, la description d’une spirale, une forme de tourbillon à la précision presque malsaine.
Un manque d’audace me contraint à rester planté sur le parking au lieu de le suivre dans les rayons pour voir avec quel genre de produits il remplirait son caddie, examiner les livres qu’il soupèserait au rayon Culture, détailler les boutiques qu’il visiterait dans la galerie marchande, celles à laquelle il jetterait un regard intéressé et celles auxquelles il ne prêterait pas attention, ces paramètres auxquelles les intelligences artificielles du lieu sont si sensibles, des interactions sociales à classifier dans les répertoires adéquats, métasignes faciaux, stases comportementales, profilage extensif du vocable, la gamme complète de signes qui définissent sa singularité.
L’agitation du parking accélérait ma perception du temps. J’imaginais quels liens pouvaient se tisser entre les badauds, les familles, les pousseurs de caddies et mon voisin qui tardait à reprendre place dans sa Ford Focus.
Un homme sorti du Centre, sans achat - l’erreur dans le programme - personne ne sort jamais d’ici les mains vides ; et si j’avais manqué l’essentiel ? Mon voisin rencontrant un espion. Je n’avais pas saisi l’opportunité, le trajet en boucle avait pour objectif de dérouter n’importe quel flic ou barbouze, sauf qu’il ne pouvait pas s’attendre à être suivi par une sorte d’écrivain enfermé à longueur de journée dans une petite maison bourgeoise réaménagée en centre de commandement opérationnel.
Il fallut attendre la mise en marche de l’éclairage pour me sortir de la transe dans laquelle je nageais. Le temps se matérialisa par la vision d’un parking déserté. Ce n’est que lorsque le Centre ferma ses portes pour la nuit que l’homme au chapeau réintégra mon champ de vision, traînant une valise bruyante que l’on aurait pu suivre à l’oreille sur des kilomètres à la ronde. L’homme s'assit sur une poubelle, se désespérant du temps froid qui repoussait la faune habituelle des parkings nocturnes. Personne pour briser le silence par quelques dérapages ou bouteilles de mélanges vodka-Monster-Energy liquidées au cul d'une voiture tuning. Le fil Twitter de l’hypermarché affichait 23H57 en lettres vertes radioactives. L'immense logo de néon trônant sur la zone éclairait les pages de mon livre, il en lut quelques lignes à voix haute, de bien trop loin pour que le son porte jusqu’à mes oreilles, mais ce sont bel et bien mes mots que j’entendis vibrer dans mes neurones. Il déchira une feuille, deux, trois, par poignées, toutes, les arracha comme une bête que l’on dépouille de sa fourrure, s’agenouilla pour mettre le feu au manuscrit. Le monde en profita pour se dissoudre plan par plan dans le décor d’un jeu vidéo qui se déchargerait faute de mémoire. Le livre s’évapora en millions de milliards de molécules de carbone. Il ne garda qu’une seule page, découpée avec le soin d’un chirurgien, qu’il me força à lire : « Vivre cent vies sans mourir, c’est n’avoir rien compris. Mourir sans avoir aimé, autant vivre sans vie ». Mon autographe, transmuté en épitaphe. Effet immédiat : je disparus atome par atome sous mes propres yeux dans une douleur indicible. « C’est pourtant le seul moyen de te libérer, Yuri », me lança-t-il.
Je réapparaîtrais dans une salle d'hôpital.
Livre à la main. Pages blanches. Fondu au gris. Mur sud. Nouvelle interface.
L’homme au chapeau patienterait sur le bord de mon lit, ne se ferait remarquer que pour s’enquérir du sujet de mon prochain livre ; sous le chapeau, un Docteur.


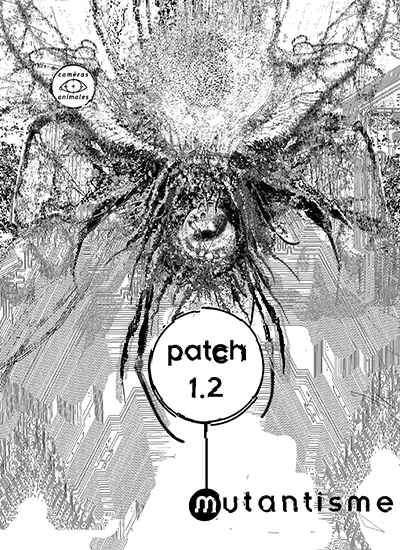


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire